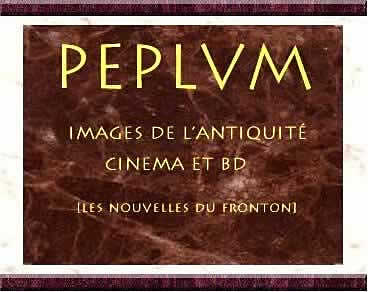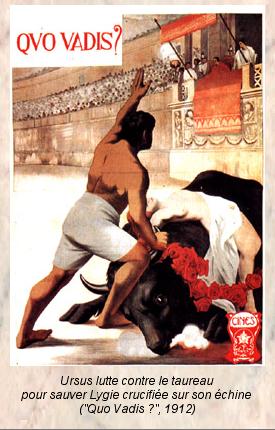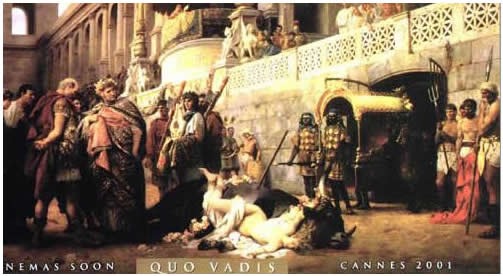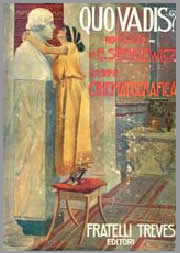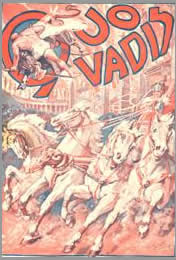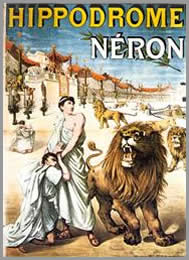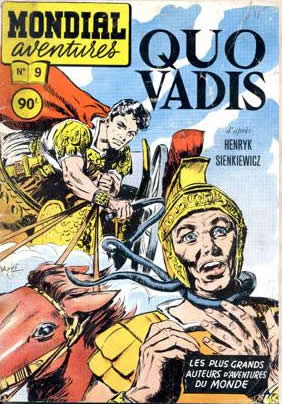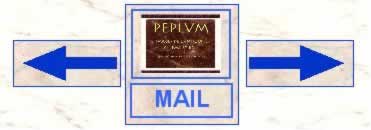| 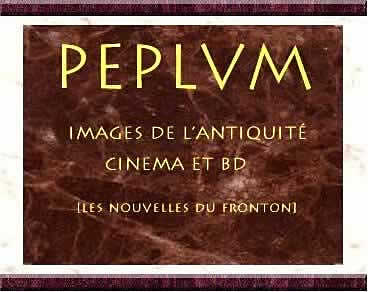
| |
Néron,
une icône satanique
La représentation de
l'impérial histrion,
d'Arrigo Boïto à Jerzy Kawalerowicz
(page 2/3)
|
"Entre-temps, la tradition chrétienne
des premiers âges se popularisait au fur et à mesure que
le christianisme se propageait dans tous les sens, et Néron devint
sous tous les rapports un monstre satanique qui le représentait
sous les traits de la Bête. La croyance du peuple qu'il reviendrait
un jour fit qu'on le regarda comme l'antithétique ennemi de Jésus-Christ
dont la Seconde Venue risquait de se heurter à celle de Néron.
(...) A la fin du XIe s., le pape Pascal II
écoutait parfois les corbeaux croasser dans un noyer qui s'élevait
sur le mont Pincius, près de la tombe des Ahenobarbi, où
les cendres de Néron étaient censées reposer, et
où se dresse maintenant l'église de Santa Maria del Popolo.
Une nuit, il rêva que ces oiseaux étaient des démons
au service de Néron, et qu'ils veillaient sur son esprit errant
sans cesse sur la colline. Il rasa donc les restes de la tombe, dissémina
les cendres et construisit cette église. Mais les corbeaux allèrent
se loger dans d'autres arbres : durant tout le Moyen Age on pensa
qu'ils étaient les domestiques en livrée noire du spectre
de l'Empereur qui errait toujours et ne cesserait d'errer dans ces parages,
jusqu'au jour où lui et Jésus-Christ reviendraient et
où Néron l'Antéchrist serait vaincu et précipité
dans le gouffre sans fond.
La vengeance des traditionalistes que l'empereur avait bafoués
fut terrible, car ils peignirent de lui le portrait d'un ennemi de l'humanité
décente; mais la vengeance de cette petite bande de chrétiens
qu'il avait si sévèrement traités fut écrasante,
car ils firent de lui l'ennemi surhumain de Dieu, et aujourd'hui même,
dix-neuf cents ans plus tard, cette ténébreuse vindicte
l'enveloppe dans une brume de préjugés hostiles."
C'est sur ces lignes que s'achève le Néron d'Arthur
Weigall (1),
nous laissant entrevoir tous les fantasmes du christianisme médiéval
et ses séquelles...
| |
C'est le moment d'être
habile ! Aux gens avisés de calculer le chiffre
de la Bête ! Car c'est le chiffre d'un homme, et
ce chiffre est six cent soixante-six."
Apocalypse, 13 : 18 - trad. Maredsous |
|
L'Antéchrist est mentionné
par l'Apocalypse (qui l'assimile à la Bête et l'associe
au nombre 666 [2]),
attribuée à saint Jean de Pathmos, et par une épître
du même Jean (3) ;
saint Paul y fait allusion comme à l'"impie" (4).
L'église catholique n'a jamais rien décidé concernant
son histoire ni sa venue, ce qui a laissé le champ libre à
toutes les spéculations.
De l'Antiquité à nos jours, pas mal de personnages historiques
ont été cités comme Antéchrist. Mais d'abord,
qu'est ce que l'Antéchrist ? Le nom est formé du
grec Ant[i], "contre" et Christos, et Littré
le définit comme un "imposteur qui, venant avant la fin des
temps, voudra établir une religion opposée à celle
de Jésus-Christ". Parmi ceux qui sont apparus avantle
Christ, ont cite Nemrod - le constructeur de la tour de Babel -,
Nabuchodonosor et Antiochus IV Epiphane. Après le
Christ, il y eut entre autres Charlemagne, restaurateur de l'Empire
romain, Napoléon, Hitler (5),
Staline, Saddam Hussein (nous en passons) et, assez bizarrement J.F. Kennedy
et... Jacques Chirac (!). Au XIVe s., les papes
Urbain VI et Clément VII se traitèrent mutuellement
d'Antéchrist. Aux yeux de certains, saint Paul lui-même
n'échappera pas à la flatteuse épithète
en ce qu'il apporta au christianisme des vues originales, qui ne concordaient
pas toujours avec celles du Christ - qu'il n'avait du reste guère
connu, au contraire des apôtres. Pour être un antéchrist,
il suffit parfois d'avoir un nom de six lettres, ou permettant une ingénieuse
combinaison en relation avec le nombre 666. Ainsi Al Gore, qui aurait
remplacé Bill Clinton en cas de malheur, aurait été
un Antéchrist potentiel comme il appert en totalisant la somme
des lettres Ascii minuscules composant son nom (!). Quelle valeur
accorder au chiffre 666, qui est "le chiffre d'un homme" (entendez :
un nom de personne) ? Nous confessons avoir un faible pour la paisible
explication du traducteur bénédictin de l'édition
de l'Abbaye de Maredsous : "Trois six suggèrent une domination
manquée, inférieure à la perfection exprimée
par le chiffre sept."
Toutefois l'Antéchrist le plus
probable fut sans doute Néron, puisque en hébreu "César
Néron" s'écrit au moyen des lettres suivantes :
kof samekh rech (100 + 60 + 200)
et noun rech vav noun (50 + 200 + 6 + 50)
soit un total de 666. Ne fut-il
pas le premier empereur romain à persécuter les chrétiens ?
Mais si l'auteur de l'Apocalypse est bien le même que l'apôtre
Jean fils de Zébédée, le "disciple préféré
du Christ" auteur du 4e Evangile comme le veut la tradition
(du reste discutée), il fut victime de la seconde persécution,
celle de Domitien, le "Néron Chauve". Au cours de celle-ci périt
T. Flavius Clemens, cousin de l'empereur, tandis que Jean était
convié à se plonger dans un chaudron d'huile bouillante (6).
Plus chanceux que Paul et Pierre sous Néron, qui n'y coupèrent
pas (7),
Jean - parce qu'il était vierge, assure La Légende
Dorée - surmonta l'épreuve, miraculeusement épargné
des brûlures, mais fut quelque temps exilé à Pathmos.
Ensuite, il retourna à Ephèse en compagnie de Marie, mère
de Jésus, et le touriste peut de nos jours encore y visiter la
petite maison où ils habitèrent, dominant le site majestueux
voué au culte de la Déesse-Mère, Cybèle
ou Artémis. Sans doute aurions-nous aimé gloser sur les
mythologies comparées - la mère du Christ/la Déesse-Mère -,
mais nous nous égarerions. Revenons à nos Néron...
chauves ou roux.
Nous avons donc Néron, le matricide
et incendiaire. Et Domitien, qui voulait se faire appeler Dominus
et Deus. Et aussi le réformateur du paganisme, Julien
l'Apostat... Et Constantin lui-même, qui favorisa l'hérésie
arienne : l'Antéchrist est souvent associé au pouvoir
temporel, celui de l'Empereur romain d'abord, de ses successeurs ensuite
(8).
Par après, il sera relié à la notion d'apostasie...
Ernest Renan, dans son Antéchrist (1878) (in Histoire
des origines du christianisme, IV), brossa un tableau attachant
du règne de Néron, amateur d'art et de belles formes tandis
que Friedrich Nietzsche, trois mois avant de se faire interner
dans un asile d'aliéné, publiait un Antéchrist,
essai d'une critique du christianisme (in Le crépuscule
des idoles, 1899)) où il massacrait la rédemption
chrétienne, la religion des petits et sans grades, au profit
de l'exaltation de l'individualisme des forts, qui seuls ont le droit
de vivre.
Si vous surfez sur la toile à
la recherche, par exemple, d'"Antechrist 666" vous risquez de tomber
sur des pages assez croquignoles où s'expriment tous les délires
statistiques de cuistres arithmomanciens, arithmosophes et autres gématriciens
disciples de Raymond Abellio (La Bible, document chiffré) :
ainsi le mot eau, symbole du baptème purificateur du péché
originel, revient 666 fois dans le TOB et le mot loi 666-1 fois
dans la Bible de Jérusalem. La longueur de la diagonale de l'antichambre
de la grande pyramide est de 666 pieds cependant que, lors de la
visite pontificale aux Etats-unis, on pouvait obtenir des renseignements
relatifs aux déplacements du Saint Père en formant un
numéro de téléphone contenant le chiffre 666.
Salomon récoltait annuellement 666 talents d'or (I Rois,
10 : 14) (et ça fait combien en kilogrammes, sachant
que 1 talent fait environ 26 kg ?) et Adonikam eut 666 fils
(Esdras, 2) !
Depuis que Rosemarie a mis au monde
son bébé (Rosemary's Baby, Roman Polanski), en
1968, le film de malédiction biblique a connu un certain succès,
où la figure de l'Antéchrist se taille une place honorable.
L'un des plus importants est sans doute The Omen (Richard Donner,
1976) où l'on voit la femme de l'ambassadeur des Etats-Unis,
Katherine Thorn (Lee Remick) accoucher d'un enfant mort-né un
6 juin à 6h du matin. Pour lui éviter une déception,
son mari y substitue un enfant sans mère qu'un individu "bienveillant"
"qui passait par là" lui propose. Ce sera Damien, l'Antéchrist,
le fils de Satan. Connu chez nous sous le titre La Malédiction,
le film aura de nombreuses suites (Damien : Omen II,
Don Taylor, 1978; The Final Conflict, Graham Baker, 1981 et,
à la TV, Omen IV : The Awakening, Jorge Montesi
et Dominique Othenin-Girard, 1991) et séquelles (L'Anticristo,
Alberto De Martino, 1974; The Exorcist, William Friedkin,
1973, où il s'agit d'un démon que sa suite - Exorcist II :
The Heretic, John Boorman, 1977 - va identifier au dieu babylonien
Pazuzu). Mais quel spectateur attentif a remarqué que, dans Les
aventuriers de l'Arche perdue, le sous-marin nazi quittant l'Egypte
pour l'archipel grec et dont on entrevoit brièvement le plan
de navigation, se dirigeait vers Pathmos pour ce fameux rituel de l'ouverture
du couvercle plombé sous lequel se trouve l'Arche de l'Alliance ?
Dans End of Days (Peter Hyams, 1999), Arnold Schwarzenegger,
dans le rôle prédestiné de Jericho Cane, le flic
qui veut mettre Satan en prison, finira par accepter d'accueillir dans
son enveloppe charnelle les forces du mal afin de les annihiler en s'autodétruisant.
En s'offrant en sacrifice. Belle abnégation chrétienne.
Le film sortit en décembre 1999, à la veille du bug
de l'an 2000 et nous eûmes très peur, vraiment, même
si la pauvre explication imaginée par le scénariste Andrew
W. Marlowe - il suffit de retourner 666 pour obtenir 1999 !
- n'était pas très subtile. L'anéantissement de
notre planète par une invasion d'extra-terrestres (Independance
Day) ou par la collision avec un météore géant
(Armaggedon), deux films-catastrophes sortis quasi en même
temps, eut aussi le don de délicieusement faire frémir
les foules, Antéchrist ou pas. (Qui donc se souvenait qu'Armaggedon
était le lieu où devait se dérouler la bataille
finale entre le Christ et l'Antéchrist ? (Apocal.,
16 : 15).) Toutefois quand le 11 septembre 2001 deux
Boeing firent un carnage tandis que George W. Bush se ruait sur
le sentier de la guerre, il ne s'agissait plus de fiction... devant
ses écrans de télévision, le monde retenait son
souffle, sauf Paco Rabane qui - plein d'espoir - reprenait sa règle
à calcul !
Le péplum n'a guère exploité
la facette "antéchristique" de Néron.
Toutefois, les cinéphiles se souviendront du remontage du Signe
de la Croix où le fils d'Agrippine était, cette fois,
clairement défini comme Antéchrist : c'était
à l'occasion de la ressortie du film, la Seconde guerre mondiale
finie. Cecil B. DeMille y avait rajouté un prologue et un
épilogue - transformant le film de 1932 en un long flash-back.
Pendant la campagne d'Italie, un bombardier américain à
bord duquel ont pris place un prêtre catholique et un pasteur
protestant, allait jeter dans le ciel de Rome des tracts pacifistes
dénonçant les antéchrists Hitler et Mussolini -
ces nouveaux Néron.
Tandis que DeMille retouchait son film, Giuseppe Maria Scotese, dans
L'Apocalypse (1946), partait de la révélation de
saint Jean de Pathmos, pour mettre en cause Julien l'Apostat (incarné
par Alfredo Varelli). L'Apocalypse (9)
fait des aller-retour avec des séquences contemporaines dénonçant
le fascisme et la bombe atomique. A la fin, tandis que l'Apostat agonise
dans les plaines de Mésopotamie, Rome brûle, ravagée
par un tremblement de terre, et les fauves échappés du
Cirque Maxime éventré errent dans les rues. Le thème
sera repris par Anthony Dawson [Antonio Margheriti] dans Les
derniers jours d'un empire (Il crollo di Roma, 1964), mais
traité avec beaucoup moins de rigueur et quasi aucune référence
à un contexte historique précis (10).
Spécialiste des effets spéciaux passé à
la réalisation, Margheriti s'en donna toutefois à cœur
joie pour filmer l'effondrement de la maquette du Colisée !
Inutile de dire que la scène n'avait rien d'historique :
comme le Veau d'Or, le Colisée est toujours debout.
Un fait historique qui consolida le
personnage de Néron dans son rôle d'Antéchrist fut
l'attente de son retour. "(...) appuyé sur quelques
passages de saint Paul lui-même, saint Jérôme présenta
Néron comme l'Ante-Christ, ou du moins comme son précurseur
- rappelle Alexandre Dumas dans les dernières pages d'Acté.
Sulpice Sévère fait dire à saint Martin dans ses
dialogues qu'avant la fin du monde Néron et l'Ante-Christ doivent
paraître, le premier dans l'Occident où il rétablira
le culte des idoles; le second dans l'Orient où il relèvera
le temple et la ville de Jérusalem pour y fixer le siège
de son empire, jusqu'à ce qu'enfin l'Ante-Christ se fasse reconnaître
pour le Messie, déclare la guerre à Néron et le
fasse périr. Enfin, saint Augustin assure, dans sa Cité
de Dieu, que, de son temps, c'est-à-dire au commencement du
cinquième siècle, beaucoup encore soutenaient au contraire
qu'il était plein de vie et de colère, caché dans
un lieu inaccessible, et conservant toute sa vigueur et sa cruauté
pour reparaître de nouveau quelque jour et remonter sur le trône
de l'empire" (11).
Refusant de croire à la mort du fils d'Agrippine, le peuple romain
- qui l'adorait - espéra longtemps le retour de Néron.
Des rumeurs circulaient annonciatrices de son retour, souvent liées
à des sosies de l'empereur qui s'étaient manifestés
(Suét., Nér., 57 et Tac., Hist., II, 8 [12]).
Il y eut au moins trois. Le premier, Terentius Maximus se signala vers 60;
le deuxième, évoqué par Tacite, parut en 70
et le troisième, mentionné par Suétone, fit parler
de lui dans les années '80. L'auteur du Juif Süss,
Lion Feuchtwanger consacrera même un roman historique au sosie
de Néron (13)
ou l'histoire d'un potier nommé Terentius, manipulé par
le sénateur Varus contre le gouverneur de Syrie, Céion,
avec l'accord tacite d'Artaban, roi des Parthes.
Dans Il Gladiatore che sfidò l'impero (bizarrement rebaptisé
de ce côté-ci des Alpes Hercule défie Spartacus
- Domenico Paolella, 1964), Gaius Terentius - puisque c'est le seul
sosie dont nous connaissions le nom véritable -, interprété
par Walter Barnes, est un gladiateur au physique herculéen dont
un sénateur dépravé, Lucius Quintilius se sert
pour s'approprier un trésor en Thrace. Contre lui va se dresser
un justicier local, nommé Spartacus (comme l'autre). Lucius va
même retourner contre Rome une de ses propres légions,
mais après quelques coups d'épée tout rentrera
finalement dans l'ordre.
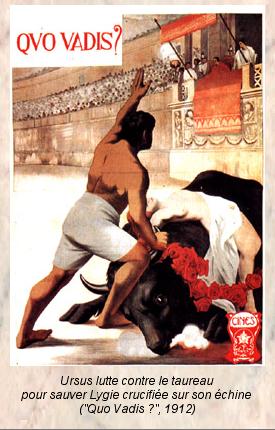 |
F. Lygie et l'aurochs
La princesse lygienne
Vers 50 de n.E., vaincu par les Romains à l'issue d'une
guerre contre leurs alliés suèves, le roi des Lygiens
(une tribu germanique de la Pologne antique) avait été
contraint de livrer sa femme et sa fille en otages garantissant le traité
de paix. Comme garde du corps, le roi avait attaché à
la personne de sa fille un guerrier d'une taille colossale, Ursus.
Un couple de patriciens romains - Aulus Paulus et son épouse
Pomponia Græcina - hébergeaient la princesse barbare et
l'aimaient comme leur fille. Son véritable nom était Callina,
mais ils l'avaient rebaptisée "Lygia", c'est-à-dire "la
Lygienne".
Pomponia Græcina était la fille d'un Pomponius Græcinius
- soit J. Pomponius, consul en 16, soit L. Pomponius,
consul en 17. Elle a réellement existé et semble
avoir été une des premières patriciennes à
s'être convertie au christianisme (en fait, Tacite dit seulement
qu'elle était "adonnée à des superstitions étrangères",
et que Néron l'abandonna au jugement de son mari, Aulus Plautius,
lequel la déclara "innocente" - Tac., An., XIII, 32).
Sous le règne de Claude, cet Aulus Plautius s'était couvert
de gloire comme gouverneur de la Bretagne, ce qui lui valut l'ovation,
honneur qu'il fut le dernier général à recevoir.
Quand à la jeune héroïne lygienne, Sienkiewicz l'imagina
à partir de deux passages de Tacite : l'un concerne un conflit
entre les Suèves, alliés de Rome, attaqués par
leurs voisins, les Lygiens. Le gouverneur de Pannonie Palpellius Hister (14),
dut traverser le Danube pour rétablir la paix, mais l'historien
romain ne parle pas d'otages donnés par les Germains (Tac., An.,
XII, 29 et 30), alors qu'au chapitre précédent on peut
lire que les Chattes, "craignant d'être enfermés d'un
côté par le Romain, de l'autre par les Chérusques,
leurs éternels ennemis, envoyèrent à Rome des ambassadeurs
et des otages. Pomponius reçut [pour cela]
les ornements du triomphe" etc. (Tac., An., XII, 28). Déduisant
que les conditions de paix imposées aux Lygiens que devaient
pas être fort différentes de celles conclues avec les Chattes,
Sienkiewcz imagine donc que son héroïne fut remise par Hister
au gouverneur de toute la Germanie, Pomponius. Lequel, conclut le romancier,
"la guerre des Chattes terminée, revint à Rome et la
confia à sa sœur, Pomponia Græcina, femme de Plautius."
Les Lygiens étaient vraisemblablement
un rameau de la nation gothe (15).
Ce peuple germanique vécut un temps en Pologne méridionale,
les Slaves n'y apparaissant que plusieurs siècles plus tard.
Maman, j'veux pas aller au cirque...
L'empereur Claude se délectait de contempler les affres de
la mort sur le visage des rétiaires (qui combattaient sans casque,
à visage découvert). Au contraire de son père adoptif,
Néron - quoique passant pour avoir été un scutarii (16)
- n'appréciait pas les combats de gladiateurs. Il en organisa
néanmoins plusieurs (notamment en 57) pour plaire au peuple,
mais n'y assistait guère (17)
(Suét., Nér., 12). Lui qui, signant en tant qu'empereur
son premier arrêt de mort déplorait avoir appris à
écrire (Suét., Nér., 10), il les eut volontiers
bannis du cirque où courraient les chars, pour les remplacer
par des jeux athlétiques comme ceux des Grecs, ou des concours
de musique et de poésie. Mais qu'importent les faits historiques :
en tant que persécuteur des chrétiens patenté,
l'historiographie populaire lui prête les instincts les plus cruels.
Le très curieux et francophobe film de science-fiction produit
par Roger Corman, La course à la mort de l'an 2000 (18),
met en scène une course automobile traversant les Etats-Unis,
où écraser vieillards et handicapés - exprès
abandonnés sur la route - apporte un maximum de points de bonification.
Les concurrents pilotent d'inénarrables véhicules. Voici
Frankenstein et son bolide noir, un Nazi aux commandes de son véhicule-V2,
etc. Et "Néron" (Martin Kove), costumé en gladiateur et
conduisant une automobile ressemblant vaguement à un char romain !
On est loin, vraiment, de la pacifique course de 57 où se
commit Néron (et qu'a reprise dans Acté Alexandre
Dumas [19]).
Bien sûr, il y eut la répression
des chrétiens. N'oublions pas que l'Antiquité fut une
dure époque, où la vie humaine n'avait pas grande valeur
(surtout s'il s'agissait de rebuts de l'Humanité comme des esclaves,
des rebelles ou des ennemis). Il n'y a pas plus de deux siècles,
sous l'Ancien Régime, on rouait vif les criminels, éclatant
à coups de barre de fer chacun des quatres membres en trois endroits
différents pour l'édification autant que l'amusement du
bon peuple, qui manquait singulièrement de distractions il est
vrai : la sinistre guillotine devait mettre un peu d'humanité
dans l'application de la peine de mort.
Ce n'est pas Néron qui a inventé les supplices appliqués
aux condamnés dans l'arène. Georges Ville (20)
a montré que la condamnation ad bestiam était réservée
aux rebelles et aux déserteurs. Ainsi Paul Emile et d'autres
firent-ils piétiner par des éléphants tout transfuge
romain capturé parmi les ennemis. Les chrétiens ayant
été - à tort ou à raison - déclarés
ennemis du genre humain, ils ne pouvaient donc échapper à
un supplice du même genre. Encore faut-il relativiser l'importance
de la répression : les disciples du Christ étaient
encore peu nombreux à Rome, aussi les historiens estiment-ils
les victimes de Néron à cent ou deux cents personnes seulement.
Tacite ne parle que de quelques individus couverts de peaux de bêtes
livrés aux chiens dans le cirque ou brûlés dans
les jardins du Vatican (Tac., An., XV, 44, 7). On est loin des
fantasmagories de Sienkiewicz qui dépeuple l'Afrique de ses fauves
pour les faire converger vers l'amphithéâtre de Rome, "des
tigres de l'Euphrate, des panthères de Numidie, des ours, des
loups, des hyènes, des chacals", qui n'auront guère
le temps de digérer leur festin de chair humaine. A peine eurent-ils
rempli leur sanglant office qu'ils étaient exterminés
à coups de flèches, ce qui était plus simple que
de les faire tous rentrer dans leurs cages. Fallait-il pour autant que
l'odieux et la surenchère le disputât à la vérité
historique ? En 1986 encore, dans la série-TV Anno
Domini - qui du reste n'était pas sans qualités -,
un groupe d'enfants chrétiens était livré
aux crocs des molosses dans le cirque... là où Tacite
parlait seulement de chrétiens, donc d'adultes. Etait-il besoin
de rajouter à l'horreur sous-jacente des textes, en substituant
à des "chrétiens"... des "enfants chrétiens" ?
Cirques, amphithéâtres et théâtres
Le public profane confond allégrement le cirque et l'amphithéâtre.
En fait, le cirque n'est rien d'autre qu'un hippodrome, le lieu où
courent les chars. C'est un long rectangle, avec une extrémité
courbe, l'autre carrée - là où se tiennent les
carceres, stalles par où les biges et les quadriges se
mettent en piste. Un mur central, appelé spina, chargé
d'ex-votos et autres accessoires sépare ceux qui remontent la
piste de ceux qui la descendent. Le cirque n'est, en principe, pas fait
pour recevoir des combats de gladiateurs (sauf les essédaires
[qui combattent en char] et les equites [cavaliers]),
mais il arrive qu'on y donne des venationes [des chasses
ou combats contre des animaux sauvages], qui exigent un décor
compliqué. C'est probablement là qu'ont lieu les exécutions
ad bestiam, lorsqu'il s'agit de traiter un grand nombre de condamnés.
L'amphithéâtre, lui, est légèrement ovale
et ressemble à deux théâtres affrontés. C'est
le lieu réservé aux combats de gladiateurs. Toutes sortes
de machineries dans son sous-sol permettent d'y amener des fauves ou
des accessoires de décors.
D'origine grecque, le théâtre se présente comme
un hémicycle de gradins, face à une scène adossée
à un long et haut mur qui lui sert de décor. Il est réservé
aux représentations théâtrales (il en existe un
modèle plus petit, l'odéon, réservé à
la musique). Dans les villes grecques soumises à Rome, il ne
fut pas rare que le théâtre serve également aux
combats de gladiateurs quand il n'y avait pas d'amphithéâtre.
C'est sans doute dans les théâtres qu'ont lieu ces snuff-movies
avant la lettre dont raffolent les Romains, où un condamné
à mort remplace dans la scène finale le protagoniste voué
à quelque atroce trépas. Catapulté dans les airs,
Icare se fracasse au pied des gradins, devant les spectateurs enthousiastes,
ou encore un taureau saillit Pasiphaé, cachée à
l'intérieur d'une génisse de bois (Suét., Nér.,
12). Apulée parle d'un mime du jugement de Paris où Vénus
est possédée par un âne et ensuite dévorée
par un fauve : une jeune femme qui avait assassiné son mari,
puis empoisonné sa fille pour garder l'héritage devait
faire les frais de cette démonstration édifiante (Apul.,
Mét., X, 28, 29 et 34) (21).
Dans le mime de Laureolus, représenté dans l'amphithéâtre
flavien (22)
à l'occasion de son inauguration par Titus, "les délices
du genre humain", un ours étripait le condamné
à mort crucifié, substitué à l'acteur de
théâtre interprétant le fameux brigand du Latium.
Dans Néropolis (23),
Hubert Monteilhet, somme toute conformiste, puisqu'il met lui aussi
l'épisode de Laureolus au programme des jeux néroniens,
glose sur l'épisode où la femme du brigand doit être
violée par un ours de Calédonie ou quelqu'autre animal
(bouc, âne). Les animaux étant moins féroces ou
pervers que l'imagination sadique des humains, il faut longtemps à
l'avance préparer ce "partenaire". La condamnée préposée
à avoir avec l'animal un rapport sexuel doit être préparée
en cohabitant avec celui-ci "et en frott(ant) journellement
son entrejambe avec des sécrétions de chèvre ou
d'ânesse en chaleur (... car) un bouc ou un âne
n'ont aucun penchant naturel pour la femme".
Nous avons évoqué plus
haut à quels sévices spéciaux Néron avait
voué les chrétiens, dans le pastiche érotique de
Ph. de Jonas Jusqu'où oseras-tu, Néron !
La couverture est une façon de gravure ancienne : sur fond
de gradins bondés par la foule, une vierge martyre est attachée
par la taille à un poteau. Sa robe déchirée ne
couvre plus que ses bras et, à partir de mi-cuisse, ses jambes.
Le sexe et les seins dénudés, la main droite posée
sur le haut de la poitrine, la tête inclinée regardant
vers le ciel, songeuse, frémissante encore, elle savoure les
délicieux tourments qu'elle vient d'endurer, après avoir
subit les assauts d'une grappe de satyres. Désormais inutiles,
un lion et une lionne ronronnent paisiblement à ses pieds.
|
| H.
Siemiradzki, "Dircé chrétienne"
(1897) : l'inspirateur inspiré… |
|
Lygie livrée à l'aurochs
Dans la fable grecque, Dircé, reine de Thèbes et marâtre
d'Amphion et Zéthos, était punie par ces derniers qui
la firent mourir en l'attachant à la queue d'un taureau sauvage.
C'est sans doute en pensant à ce supplice mythologique, qu'H. Sienkiewicz
- qui avait rencontré à Rome le sculpteur Pius Welonski
et le peintre Henryk Siemiradzki (Dircé chrétienne,
1897) - imagina les tourments infligés à son héroïne
Lygie. Il pouvait du reste étayer cette scène-clou de
son roman par l'exemple de sainte Blandine et des martyrs de Lyon (Eusèbe,
Histoire ecclésiastique, V, 1, 17-56 - mais selon D. Beauvois,
cette description proviendrait de L'Antéchrist d'E. Renan).
En 177, sous Marc Aurèle, la vierge chrétienne Blandine
refusa d'abjurer sa foi et périt déchirée par les
cornes d'un taureau. Blandine faisait partie d'une secte de chrétiens-ultras,
les Montanistes, qui aspiraient au martyre. Après avoir subi
divers supplices (le fouet, le feu), été attachée
à un poteau et exposée aux fauves qui - miraculeusement
- ne la touchèrent pas, elle fut finalement garrottée
dans un filet et livrée au taureau qui la lança en l'air
à plusieurs reprises. C'est Blandine rompue par l'animal cornu
qui inspira et le supplice de Lygie, sous Néron (Quo Vadis ?,
1895) et la toile de Siemiradzki (1897) où l'on voit le fils
d'Agrippine, perplexe, arpenter en compagnie de quelques dignitaires
l'arène jonchée de ses sanglantes victimes (24).
Pour le spectateur assis dans la salle
obscure, le Peuple-Roi n'avait vraiment rien d'autre à faire
que d'assister à des supplices de chrétiens ! Ainsi,
et bien qu'aucun film n'ait été consacré à
Blandine, son supplice est-il mis en abîme. De "on-dit" en hagiographies,
il se répercutera indéfiniment dans notre imaginaire.
C.B. DeMille y ajoutera même une variante, en remplaçant
le taureau par un cynocéphale dans Le Signe de la Croix (25).
Le film concluait sur le martyre des chrétiens en montrant l'héroïne
Mercia (Elissa Landi), nue et parée de guirlandes de fleurs,
liée à un poteau et livrée à la concupiscence
d'un cynocéphale - caricature d'humanité que le spectateur
imaginera selon ses goûts libidineux ou sanguinaire, ou les deux.
Mais si le cinéaste ne concluait pas, d'autres le feront pour
lui : tel dessinateur de BD, remplaçant le cynocéphale
par un gorille albinos des plus viril ne nous épargnera aucun
détail du martyre enduré par la malheureuse jeune personne (26).
Cette scène anthologique fera fantasmer nombre de dessinateurs
érotiques qui lui donneront divers développements comme
l'Anglais David Gray (27)
ou, d'une inspiration plus classique, tel épisode de La saga
d'Iron-Jaw (28),
bande d'heroïc fantasy inspirée de Conan, où
l'on voit dans un moyen-âge postapocalyptique, garrottée
à un poteau, une jeune fille offerte à des ours, chastes
probablement quoiqu'à leur façon féroces amateurs
de chair fraîche... Nous avouons ignorer pourquoi le finaud DeMille
mit dans son film un singe plutôt que l'ours de Laureolus, l'âne
d'Apulée ou le taureau de Blandine mais une allusion à
la "Belle" et la "Bête" de King Kong, qui allait sortir
sur les écrans quelques mois plus tard, nous paraît assez
évidente (29).
Du sadomasochisme dans les péplums (30)
"On peut violer l'histoire à condition de lui faire un
bel enfant", assurait Alexandre Dumas. Si trois des "Quatre Evangiles
du péplum" ont été écrits en anglais, il
serait bon de rappeler que des Martyrs (1809) de Chateaubriand
à Salammbô (1862) de Flaubert, la France n'est pas
demeurée en reste. Bien avant Lewis Wallace et Henryk Sienkiewicz,
Alexandre Dumas (31),
dans Acté (1839), avait décrit une superbe course
de chars et livré aux bêtes une blonde héroïne
chrétienne.
Inspirés par les toiles de Styka et de Siemiradzki, les différents
adaptateurs à l'écran de Quo Vadis ? réussirent
à plus ou moins bien mettre en scène le difficile épisode
de Lygie, crucifiée nue sur l'échine d'un aurochs. La
pudique version 1912 avait fait son bonheur d'une poupée de chiffons
(contrairement à ce que suggère le matériel publicitaire
de l'époque, racoleur par définition), tandis que la version
1924 s'était fort honorablement tirée d'affaire avec un
montage alternant des gros plans de l'actrice - laissant entrevoir un
sein neigeux - et des plans généraux où l'on devinait
un mannequin sur le dos de la bête. Mais comme cette version signée
par Georg Jacoby et Gabriellino D'Annunzio se voulait un peu plus coquine
que la précédente, dès les premiers plans du film
le "méchant" Néron expédiait aux murènes
une de ses esclaves à la gorge dénudée ! Belle
entrée en la matière... La version de Kawalerowicz fait
également très fort : on ne voit pas la différence
entre les plans avec l'actrice (que l'on devine tétanisée
par la peur) et ceux avec le mannequin. Détail piquant, le film
respecte le décentrage du corps de Lygia vers la droite de l'animal,
conformément à la représentation par Styka. La
position centrale était intenable, chaque cahot de l'animal étant
particulièrement douloureux. On regrettera seulement l'usage
d'un (discret) harnais de cuir noir qui semble sorti d'un magasin d'accessoires
sadomasochistes, et que les guirlandes de fleurs ne dissimulent pas
entièrement - vu le contexte archéologique, de la solide
corde de chanvre nous eut paru préférable. Erreur de story-board ?
A aucun moment la caméra ne capte le visage de Lygia, qu'on imaginerait
folle de terreur, mais que Kawalerowicz filme inerte, évanouie
peut-être ?
Dumas fut sans doute le seul à
décrire Néron comme un demi-dieu athlétique, capable
d'exploits sportifs - comme triompher dans une course de chars ou comme
lutteur -, autant qu'il était doué pour le chant
également. Détail piquant, Néron s'y fait accompagner
partout par une tigresse, Phœbé. Antinéa, la reine
de l'Atlantide, se contentait d'un guépard (dans la version cinématographie
de Quo Vadis ?, 1951, Poppée en a deux, na !)
- mais Hiram-Roi n'avait d'autre utilité que servir de métaphore
érotique. Habitué à la présence d'Acté,
la tigresse Phœbé se devait, en la retrouvant, de donner
une heureuse conclusion au supplice de la jeune grecque attachée
à un arbre planté au milieu de l'arène. Acté
y était la chèvre, et le gladiateur Silas devait écarter
et tuer les fauves, ou périr sous leurs crocs. Ce qu'il advint.
C'est cette solution de l'arbre ou du poteau que retinrent, pour des
raisons de sécurité, C.B. DeMille (Le Signe de la Croix,
1932), Mervyn Le Roy (Quo Vadis ?, 1951) et Franco
Rossi (Quo Vadis ?, TV, 1984). Dans Ursus/La Fureur d'Hercule
(Carlo Campogalliani, 1960), Ursus
revenant de la guerre apprenait que sa fiancée Actée [Attea,
V.O.] a été enlevée. Parti à sa recherche,
il fut faudra lutter dans l'arène pour sauver non pas une mais
deux jeunes filles attachées à un poteau où
un taureau doit les encorner.
La séquence de Lygie et du taureau
est un des clous du sadomasochisme pépluméen, où
tout réside dans la suggestion plutôt que dans les images
sanguinolentes de chairs déchiquetées. Ursus réussira-t-il
à contenir la Bête (véritable métaphore de
l'Antéchrist Néron) ? En renversant l'animal au luisant
pelage d'ébène, ne risque-t-il pas d'écraser la
frêle jeune fille qu'il porte sur son dos ? Montherlant fantasmait-il
sur le taureau ou sur le matador ? nous n'en savons rien. Mais
le commun des mortels lèvera le pouce pour Lygie, s'arc-boutera
avec Ursus. Le(s) film(s) comme le roman ne manquaient pas de suggestions
masochistes.
Ainsi tous ces inflexibles candidats au martyre qui se refusent à
apostasier pour sauver leur vie... Bien sûr, il y a Pierre, toujours
courageux, qui au chant du coq laisse tomber ses disciples pour aller
ailleurs planter ses choux, quand un discret rappel à l'ordre
d'En-Haut vient rappeler le titre de l'œuvre : "Où
vas-tu ?"
Que ces questions existentielles ne nous détournent pas de
la simple vie quotidienne. On savait s'amuser, à Rome. Et le
libertin Pétrone savait y faire avec ces dames, ses esclaves
(Chap. XII et XIII). A commencer par la plus dévouée,
Eunice, que, quelque peu "échangiste", il veut repasser à
son neveu Vinicius. Amoureuse de son maître, Eunice se rebiffe
un tant soit peu, aussi lui fait-il administrer par son atriensis
Teirésias (son majordome, si vous voulez) "vingt-cinq coups
de verge, mais sans abîmer la peau".
|
Eunice, l'esclave amoureuse de son maître
("Quo Vadis", versions 1912 et 1924) |
Deux paragraphes plus loin, il s'informe :
"- As tu reçu les verges ?
Elle se jeta de nouveau à ses pieds et baisa le bord de sa
toge.
- Oui, seigneur ! J'ai reçu les verges ! Oui, seigneur !...
Sa voix était vibrante de joie et de gratitude. [Elle
espère ne pas être renvoyée chez Vinicius.]
(...)
Mais il [Pétrone, qui croit Eunice amoureuse d'un
quelconque esclave de sa maison] connaissait trop à
fond l'âme humaine pour ne pas deviner que l'amour seul pouvait
susciter une pareille obstination."
Le principal intéressé
est toujours le dernier informé. Pétrone ignore être
l'objet de la flamme de celle qui, à la fin du roman, quémandera
comme une faveur de pouvoir mourir avec son maître qui vient de
se faire trancher les veines. Un peu plus loin, Eunice lui confie avoir
rencontré un diseur de bonne aventure :
"- Et que t'a-t-il prédit ?
- Qu'une souffrance et un bonheur m'attendaient.
- La souffrance t'est venue par la main de Teirésias; la prédiction
du bonheur doit également se réaliser.
- Elle s'est déjà réalisée, seigneur.
- Comment ?
Elle murmura :
- Je suis restée.
Pétrone posa sa main sur la blonde tête d'Eunice.
- Tu as bien disposé les plis [de ma toge] aujourd'hui,
et je suis content de toi, Eunice.
Dès que la main de Pétrone l'eût touchée,
ses yeux se voilèrent d'une buée de félicité
et sa gorge tressaillit."
De l'Hippodrome forain au Gaumont-Palace
Nous évoquions plus haut les différents types de bâtiments
où se déroulaient les sanglants jeux romains. Ils marquèrent
l'imagination au point que le mot "cirque" restera accolé à
nos spectacles forains, avec lesquels ils n'avaient pourtant aucune
continuité historique. Fin du XIXe s., il y avait
à Paris cinq hippodromes forains. Il s'agissait d'établissements
stables qui, tel l'Hippodrome du Pont de l'Alma (inauguré en
juin 1877), reconstituaient à leur manière les fastes
de l'antique Circus Maximus : "La piste... mesurait 84
mètres sur 48 mètres, et une immense verrière coulissante
pouvait la protéger en cas d'intempéries ! L'établissement
était pourvu de l'éclairage électrique, et ses
dépendances abritaient toutes sortes d'ateliers qui rendaient
possibles la réalisation sur place de décors, selleries,
costumes, l'entretien des chars de parade, etc. Son directeur, monsieur
Zidler, y présidait de grandes pantomimes servies par une importante
machinerie (32)".
Une affiche Néron, signée
par Emile Lévy, nous a conservé l'ambiance d'un des spectacles
de l'Hippodrome de l'Alma : le cirque antique avec ses chrétiens
crucifiés ou pourchassés par les lions - comme sur les
toiles de Styka ou de Gérôme.
"Pour Néron, une immense grille de 4,50 m de haut et qui ceinturait
la grande piste dans tout son périmètre, sortait du sol
mue par un système hydraulique, pour le tableau dans lequel paraissaient
les lions du cirque romain. Les lions entraient en piste par un ascenseur
muni d'une cage qui était chargée dans le sous-sol" (33).
|
L'opéra "Quo Vadis ?" (Caïn
& Nouguès, 1909) au Heysel (Bruxelles, 1936)
et le spectacle forain "Néron" à l'Hippodrome du
Pont de l'Alma (Paris) |
De roman (1895), Quo Vadis
était devenu peinture (Siemiradzki, 1897; Styka, 1899), avant
que d'être opéra (Caïn & Nouguès, 1909),
spectacle forain (Alma (Paris) ou au Heysel (Bruxelles, 1936)), puis
films cinématographiques voire série-TV, sans oublier
les nombreuses adaptations en bandes dessinées tirées
soit du roman, soit du film, etc. Aussi n'est-ce pas par hasard que
l'on verra tel autre hippodrome forain, celui de la place de Clichy
édifié pour l'exposition de 1900, après avoir
été provisoirement transformé en patinoire, devenir,
le 11 octobre 1911, le plus grand cinéma d'Europe : le
Gaumont-Palace. L'"endroit privilégié où
se tiend(ront) les grandes premières de la Gaumont et
les galas officiels de la IIIe République" (34).
Et c'est ce véritable temple dédié au culte cinématographique,
qui va afficher en grande première, en 1912... le Quo Vadis
d'Enrico Guazzoni, avec la musique de l'opéra de Nouguès !
Honte à cet effronté
qui peut chanter pendant
Que Rome brûle, ell' brûl' tout l'temps...
Signalons un intéressant
site consacré au roman d'H. Sienkiewicz : quovadis.oeuvre.free.fr
Suite…
| Sur
le site associé

- Néron - Notice biographique : Clic
!
- Néron - des livres et des liens : Clic
!
|
NOTES :
(1)
Arthur Weigall, Néron, Payot, 1950, pp. 342-343.
- Retour texte
(2) Apocal.,
13 : 18; 17. - Retour
texte
(3)
I Jean, 2 : 18 etc.; 4 : 3; II Jean,
7. - Retour texte
(4)
II Thessal., 2 : 8. - Retour
texte
(5)
La gravité des crimes contre l'humanité du IIIe Reich,
sa haine du christianisme ont fait d'Adolf Hitler un "Antéchrist"
très convaincant, d'autant plus que la marque au front
(l'aigle à croix gammée, sur les casquettes) et
celle à la main droite (le tatouage sur de poignet des
victimes des camps de la mort) distinguent bien maîtres
et esclaves, comme il est question au verset 16 (Apocal.,
13 : 16).
Renée Davis (La croix gammée, cette énigme,
Presses de la Cité, 1967, pp. 33-37) a son opinion
quant à la manière dont il faut lire le chiffre
666 (grec). L'alphabet grec classique que nous utilisons est
en fait l'alphabet athénien/milésien. Les Grecs
notaient les chiffres au moyen des 24 lettres de leur alphabet
plus 3 caractères archaïques autrement tombés
en désuétude : le sti (ou bau)
pour 6, le koppa pour 90, et le sampi
pour 900. Mais d'une ville à l'autre il pouvait
exister des variantes, ainsi selon Davis qui s'appuie sur des
grammaires conservées à la Bibliothèque
Mazarine (Grammaire grecque de Ragon, n° du
cat. 76 620; Grammaire de Koch, n° 24 591,
p. 70, par. 39, note 1 - citées par Davis,
op. cit., p. 37), le chiffre 6, à Pathmos,
aurait été exprimé par une autre lettre
archaïque, le digamma. R. Davis représente
ce digamma comme un simple gamma et y voit une
allusion à la croix gammée alors que normalement
un digamma, étant fait de deux gammas superposés,
ressemble plutôt à la lettre latine F.
Nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier dans les deux
grammaires citées mais, à trop vouloir prouver...
- Retour texte
(6)
Cf. Jacques de Voragine, La légende dorée
(XIIIe s.), Garnier-Flammarion, 2 vols,
1967, I, p. 81. - Retour
texte
(7)
... selon la légende chrétienne, bien sûr.
- Retour texte
(8)
On se reportera à la notice de Ramon Trevijano, s.v.
"Antéchrist" in [Angelo Di Berardino (sous la dir.)
- François Vial (adapt. fr.)], Dictionnaire encyclopédique
du christianisme ancien (Dizionario patristico e di antichità
cristiane, 1983), Cerf, 1990. Selon Trevijano, la réunion
du démon Béliar avec Néron sous le terme
"Antéchrist" disparaît à partir du IIIe s.
- Retour texte
(9)
Des Quatre cavaliers de l'Apocalypse (Vincente Minelli,
1962) à Apocalypse Now (F. Coppola, 1979)
sans oublier Le cinquième cavalier de Lapierre
et Collins, l'Apocalypse est la métaphore par excellence
de la folie guerrière. - Retour
texte
(10)
L'action se déroule-t-elle en 340 ? Ou en 364 ?
- Retour texte
(11)
Alexandre Dumas, Acté, Presses Pocket, n°
2291, pp. 216-217. Ici Dumas assimile Néron
à la Bête, qu'il distingue de l'Antéchrist.
Selon l'interprétation, l'Antéchrist (gr. Antichristos,
lat. Antichristus) annonce, précède (ante)
le Christ, ou le combat (anti). - Retour
texte
(12)
Cf. aussi Arthur Weigall, Néron, Payot,
1950, p. 335 (qui cite Dion Cassius, LXVI, 19; Jean d'Antioche,
frag. 104 (Müller) et Suétone, Néron,
57). - Retour
texte
(13)
Lion Feuchtwanger, Néron l'imposteur (Der Falsche
Nero, 1963), Jean-Cyrille Godefroy éd., 1984. - Retour
texte
(14)
Sienkiewicz le nomme Atelius Hister. - Retour
texte
(15)
Sur les Lygiens de la Pologne antique - Celtes ou Germains ?
-, cf. Herwig Wolfram, Histoire des Goths (1979),
Albin Michel, 1990, p. 53 et passim. - Retour
texte
(16)
Georges Ville, La gladiature en Occident, des origines à
la mort de Domitien, Ecole française de Rome, 1981,
p. 444. Les scutari, ou porteurs de scutum
ou bouclier long, sont les Mirmillons, généralement
oppposés aux Thraces ou parmulari ("porteurs du petit
bouclier" ou parmula). Leurs supporteurs sont appelés
respectivement scutarii et parmularii. - Retour
texte
(17)
Cizek, Néron, p. 124. - Retour
texte
(18)
Death race 2000, de Paul Bartel (EU, 1975 - rééd.:
Les seigneurs de la route). - Retour
texte
(19)
Qui la situe anachroniquement en 67, lors de l'impériale
tournée en Grèce... - Retour
texte
(20)
Georges Ville, La gladiature en Occident, op. cit. -
Retour texte
(21)
L'épisode a été mis en BD par Georges Pichard,
Les Sorcières de Thessalie, Glénat, 2 vols,
1984 et Milo Manara, La métamorphose de Lucius,
Les Humanoïdes Associés, 1999.
Les métamorphoses (L'Ane d'or) d'Apulée
de Madaure, ont également été portées
à l'écran par Sergio Spina : L'Asino d'oro :
processo per fatti strani contro Lucius Apuleius, cittadino
romano (Italie-Algérie, 1971), avec Samy Pavel et
Barbara Bouchet - mais nous ignorons si l'épisode de
la meurtrière condamnée à être, dans
l'amphithéâtre, possédée par un âne
[Lucius, qui a ainsi été métamorphosé
par une sorcière], épisode final du roman
d'Apulée, y figure effectivement. - Retour
texte
(22)
Le Colisée, à Rome. - Retour
texte
(23)
Hubert Monteilhet, Néropolis, Julliard-Pauvert,
1984, pp. 611-616. - Retour
texte
(24)
Dircé chrétienne est du reste abondamment
citée dans le matériel publicitaire du film de
Kawalerowicz. - Retour
texte
(25)
Sienkiewicz avait vendu au Britannique Wilson Barrett les droits
d'adaptation théâtrale de Quo Vadis ? :
ce fut Le Signe de la Croix. - Retour
texte
(26)
Michel Duveaux, Caligula, Centre audi visuel de productions,
coll. Bédé X, s.d. (1992), pll. 5-7.
Du sadisme antique, Duveaux compose de curieux tableaux tachistes
ou pointillistes, patchwork de photos de péplum.
- Retour texte
(27)
David Gray, Brutus, Whyteleafe (Surrey), Gadoline éd.,
1971. - Retour
texte
(28)
Michael Fleisher (sc.) et Mike Sekowsky & Pablo Marcos (d.),
La saga d'Iron-Jaw (Seabord Periodicals Inc., 1975),
Lyon, Lug éd., 1976, pl. 23-25. - Retour
texte
(29)
Le signe de la Croix sort en France vers décembre
1932 et King Kong (sorti à Hollywood le 2 mars
1933) le 4 novembre 1933, à Paris. - Retour
texte
(30) La
question a été évoquée d'une manière
assez générale par Jean Streff, "Aux pieds d'Omphale
- Le masochisme dans les péplums", Le masochisme au
cinéma, Veyrier, 1978, pp. 191-199. -
Retour texte
(31) Alexandre
Dumas n'a que fort peu traité de l'Antiquité.
Outre deux pièces de théâtre (Caligula,
1837 et Catilina, 1848), il a évoqué la
chute de Jérusalem, en 70, dans sa version du "Juif
errant" : Isaac Laquedem (1852). - Retour
texte
(32) Dominique
Jando, Histoire mondiale du cirque, éd. Jean-Pierre
Delarge, 1977, p. 26 et 39. - Retour
texte
(33) D.
Jando, Ibidem, qui reproduit l'affiche de "Néron"
à l'Hippodrome de l'Alma (doc. Musée des Arts
Décoratifs). - Retour texte
(34) Francis
Lacloche, Architectures de cinémas, Paris, éd.
du Moniteur, 1981, p. 77-79, 193, 213. - Retour
texte
|
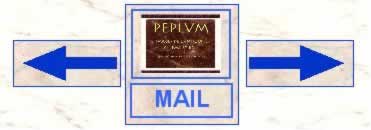
|