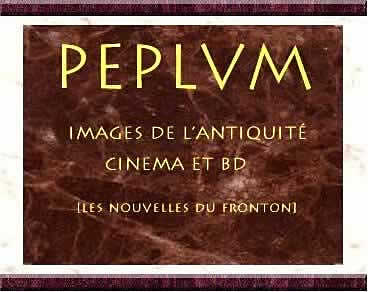 |
| |
| |
Die Hermannsschlacht
(La bataille d'Arminius)
Page 8/8
|
|
| 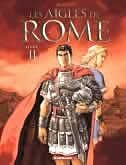
Arminius en BD. Gagnez un album
des Aigles de
Rome (Enrico Marini) en participant au concours. |
|
|
Pages précédentes :
I. L'aventure
est dans la Forêt...
DIE
HERMANNSSCHLACHT (1993-1995)
1. Arminius
dans la littérature allemande, avant Kleist
2. Heinrich
von Kleist (1777-1811)
3. Christian
Dietrich Grabbe (1801-1836)
ENCYCLOPÉDIE
1. Les Romains
en Germanie
2. Arminius
(18 av. n.E. - 19 de n.E.)
3. Marbod,
roi des Marcomans
4. P. Quintilius
Varus (46 av. n.E. (?) - 9 de n.E.
5. Le massacre
du Teutoburger Wald
6. L'emplacement
de la bataille
7. Arminius
à l'écran
II. Pour qui
sonne le glas...
IL MASSACRO DELLA FORESTA NERA
(1965)
FILMOGRAPHIE
8. Documentaires
9. Fictions
BIBLIOGRAPHIE
BANDE DESSINÉE
MUSICOGRAPHIE
INTERNET
Sur cette page :
SOURCES
- Le cénotaphe du centurion
Marcus Cælius
- FLORUS, Abrégé
d'histoire romaine, IV, 12
- VELLEIUS PATERCULUS,
Historiæ Romanæ libri duo, CXVII-CXXI
- DION CASSIUS, Histoire
romaine, LVI, 18-24
- TACITE, Annales,
I, 60-62
En guise d'épitaphe...
|
|
|
SOURCES
- Le cénotaphe du centurion Marcus
Cælius
- FLORUS, Abrégé
d'histoire romaine, IV, 12
- VELLEIUS PATERCULUS, Historiæ
Romanæ libri duo, CXVII-CXXI
- DION CASSIUS, Histoire
romaine, LVI, 18-24
- TACITE, Annales,
I, 60-62
|
|
| 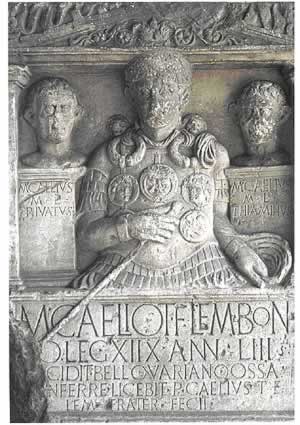
Le cénotaphe du centurion M. Cælius |
|
| |
Le cénotaphe
du centurion Marcus Cælius
M(arco) CÆLIO T(iti) F(ilio) LEM(onia tribu)
BON(onia domo)
(centurio) leg(ionis) XIIX ANN(orum) LIII s(emissis).
[ce]CIDIT BELLO VARIANO OSSA
[i]NFERRE LICEBIT P(ublius) CÆLIVS T(iti) F(ilius)
LEM(onia tribu) FRATER FECIT
Pour Marcus Cælius, fils de Titus, de
la tribu Lemonia, originaire de Bologne, centurion de la 18e
légion, âgé de 53 ans et demi. Il est tombé
à la guerre de Varus. Il sera permis d'amener ses restes.
Publius Cælius, fils de Titus, de la tribu Lemonia, son
frère, a fait faire ce monument.
(ILS, 2244 = CIRh, 209 - conservé
au Rheinisches Landesmuseum, Bonn)
Ce cénotaphe fut découvert en 1630.
Le centurion est représenté en grande tenue avec
toutes ses décorations : armilles, colliers (torques),
bracelets et phalères; il porte la couronne civique en
feuilles de chêne, distinction réservée à
ceux qui ont sauvé un compagnon d'armes au combat, et il
tient le cep de vigne symbole de son grade. Son âge avancé
(vers 5-6 de n.E., le temps d'engagement pour un légionnaire
était de vingt ans, mais il n'était pas rare qu'ils
en passent trente et plus sous les drapeaux - TAC., An.,
I, 35) suggère qu'il devait appartenir à une vexillation
de vétérans (vexillum veteranorum) ou occuper
un haut grade dans la hiérarchie des centurions, peut-être
un primipilaire.
|
| |
| 
Le last stand du
centurion M. Cælius, vu par Angus McBride. Chargeant
à la tête d'une vexillation de vétérans
de la XVIIIe légion (ou plutôt de la XIIX,
pour respecter le texte épigraphique), le personnage
du cénotaphe de Xanten livre son baroud d'honneur.
L'artiste britannique lui a mis toutes ses décorations
et sa couronne civique, comme sur son portrait funèbre.
Notez le vexillaire au masque de métal, et le calone
- valet d'armes - qui brandit une arme de fortune, la
redoutable dolabre. (Extr. Ross COWAN & Angus McBRIDE,
Le légionnaire romain de 58 av. J.-C. à
69 apr. J.-C., Osprey Publishing-del Prado éditeurs,
coll. «Armées et Batailles», nĘ 7,
2003)
|
|
|
ANNAEUS JULIUS FLORUS
Abrégé d'histoire romaine (IV,
12)
On ne sait rien d'Annæus Julius Florus, sauf qu'il
était probablement originaire d'Espagne et qu'il vécut
sous Trajan et Hadrien. Il écrivit un abrégé
d'Histoire romaine en quatre livres, allant de la fondation
de Rome en 753 av. n.E. à 9 de n.E.). Son œuvre
fut publiée à la fin du règne d'Hadrien.
La présente traduction de l'Abrégé
de l'Histoire romaine est tirée de la «Collection
des Auteurs latins : Salluste, Jules César, C. Velleius
Paterculus et A. Florus» publiés sous la direction
de M. Nisard (Paris, Firmin Didot, 1865). On en trouvera la
traduction complète sur le site
de Philippe Remacle.
Quant à la Germanie, plût au ciel que César
eût attaché moins d'importance à sa conquête
! Nous eûmes plus de honte à la perdre que de gloire
à la soumettre. Mais sachant que César, son père,
avait passé deux fois le Rhin sur un pont pour y chercher
l'ennemi, il voulut en faire une province pour honorer sa mémoire.
Il y eût réussi, si les barbares avaient pu supporter
nos vices comme notre domination. Drusus, envoyé dans cette
province, dompta d'abord les Usipètes; puis il parcourut
le pays des Tenchtères et des Cattes [Chattes]; et sur
un tertre élevé, il dressa un trophée des
riches dépouilles remportées sur les Marcomans.
Puis il attaqua en même temps des peuples très
puissants, les Chérusques, les Suèves et les Sygambres.
Ils avaient mis en croix vingt centurions, et ce crime avait été
comme le serment par lequel ils s'étaient engagés
à la guerre. Sûrs de la victoire, ils s'entendirent
pour se partager d'avance le butin. Les Chérusques avaient
choisi les chevaux, les Suèves, l'or et l'argent, les Sygambres,
les prisonniers. Mais ce fut le contraire qui se produisit. Drusus,
vainqueur, distribua et vendit comme butin leurs chevaux, leurs
troupeaux, leurs colliers et leurs personnes mêmes. En outre,
pour défendre la province, il établit des garnisons
et des petits postes partout sur les bords de la Meuse, de l'Elbe
et du Veser. Le long du Rhin, il éleva plus de cinquante
ouvrages fortifiés; il fit construire des ponts à
Bonn et à Mayence, et des flottes pour les protéger.
Il ouvrit aux Romains la forêt hercynienne, jusqu'alors
inconnue et inaccessible. Enfin, la paix régnait si bien
en Germanie que les hommes semblaient changés, le pays
tout autre, et le ciel lui-même plus doux et plus agréable
qu'auparavant. Enfin ce n'est point par flatterie, mais par reconnaissance
pour les services rendus, qu'à la mort de ce jeune héros
le sénat lui accorda une distinction jusque-là sans
exemple, en lui décernant lui-même un surnom tiré
de la province qu'il avait soumise.
Mais il est plus difficile de garder les provinces que de
les conquérir. La force les soumet, la justice les conserve.
Aussi notre joie fut-elle de courte durée. Les Germains
étaient vaincus plutôt que domptés, et sous
un général tel que Drusus, ils s'inclinaient devant
la supériorité de nos mœurs plutôt que
devant celle de nos armes. Mais après la mort de Drusus,
Quintilius Varus leur devint odieux par ses caprices et son orgueil,
non moins que par sa cruauté. Il osa les réunir
en assemblée et commit l'imprudence de leur rendre la justice,
comme s'il eût suffi des verges d'un licteur et de la voix
d'un huissier pour réprimer l'humeur violente de ces barbares.
Mais les Germains depuis longtemps regrettaient de voir leurs
épées rouillées et leurs chevaux oisifs.
Dès qu'ils se rendirent compte que nos toges et nos lois
étaient plus cruelles que nos armes, ils se soulevèrent
sous la conduite d'Arminius. Cependant Varus avait une telle confiance
dans le maintien de la paix, qu'il resta indifférent aux
renseignements que Ségeste, l'un des chefs germains, lui
révéla sur la conjuration. Il ne prévoyait
ni ne craignait rien de tel, et dans une sécurité
trompeuse il les citait à son tribunal, lorsqu'ils l'attaquent
à l'improviste et se jettent partout sur ses troupes. Son
camp est emporté, ses trois légions sont écrasées.
Varus, après le désastre, eut le même destin
et montra le même courage que Paulus après la journée
de Cannes. Rien de plus sanglant que ce carnage dans les marais
et dans les bois, rien de plus révoltant que les outrages
des barbares, surtout à l'égard des avocats. Aux
uns ils crevaient les yeux, aux autres ils coupaient les mains.
A l'un d'eux ils cousirent la bouche, après lui avoir d'abord
coupé la langue, qu'un barbare tenait à la main,
en disant : «Vipère, cesse enfin de siffler.»
Le cadavre même du consul, que la piété des
soldats avait enterré, fut exhumé. Les barbares
possèdent encore des drapeaux et deux aigles. Quant à
la troisième, un porte-enseigne l'arracha de sa pique avant
qu'elle ne tombât entre les mains de l'ennemi, la dissimula
à l'intérieur de son baudrier, et alla se cacher
dans un marais ensanglanté. Ce désastre obligea
l'empire, que n'avait pu arrêter le rivage de l'océan,
à s'arrêter sur les bords du Rhin. Tels furent les
événements au Septentrion.
|
|
VELLEIUS PATERCULUS
Historiæ Romanæ libri duo, CXVII-CXXI
Originaire de Campanie, C. Velleius Paterculus (20 av. n.E.-30
de n.E.) fut préfet de cavalerie de Tibère en
Germanie. Son père, qui avait servi dans les rangs de
Marc Antoine sous les ordres de Tib. Claudius Nero - le père
du futur empereur Tibère à la fortune duquel l'historien
restera attaché - se suicida après le triomphe
d'Octave.
L'Histoire Romaine de Velleius Paterculus qui va du retour
de Troie au règne de Tibère (dont l'écrivain
est le thuriféraire) est dédiée au consul
Marcus Vinicius. On trouvera la traduction intégrale
de son ouvrage sur le site
de Philippe Remacle.
CXVII. - César venait à peine de terminer la
guerre de Pannonie et de Dalmatie quand, moins de cinq jours après
qu'il eut achevé une tâche si importante, des lettres
funestes arrivèrent de Germanie. Elles annonçaient
la mort de Varus, le massacre de trois légions, de trois
corps de cavalerie et de six cohortes. La fortune ne nous fut
indulgente que sur un point... et le personnage de Varus demande
qu'on s'y arrête. Quintilius Varus descendait d'une famille
plutôt illustre que noble. C'était un homme naturellement
doux, de mœurs tranquilles, un peu lourd d'esprit comme de
corps, et plus accoutumé à la calme vie des camps
qu'aux fatigues de la guerre. Il était loin de mépriser
l'argent, comme peut en témoigner la Syrie qu'il eut sous
son autorité : elle était riche et lui pauvre quand
il arriva; à son départ elle était pauvre
et il était riche. Placé à la tête
des troupes qui se trouvaient en Germanie, il s'imagina que ces
barbares qui n'avaient d'humain que la voix et les membres, étaient
véritablement des hommes et que les lois pourraient adoucir
ceux que l'épée n'avait pu dompter. C'est avec de
tels desseins qu'il pénétra au cœur de la Germanie.
Il s'y comporta comme s'il était parmi des gens qui goûtent
la douceur de la paix et passa le temps de la campagne d'été
à rendre la justice et à prononcer des arrêts
du haut de son tribunal.
CXVIII. - Mais, chose à peine croyable pour qui n'a
pu en juger par lui-même, les Germains, peuple né
pour le mensonge, témoignèrent dans leur extrême
barbarie de la plus grande astuce. Ils inventèrent de toutes
pièces une série de procès; tantôt
ils se cherchaient querelle les uns aux autres; tantôt ils
nous remerciaient de ce qu'ils voyaient leurs disputes apaisées
par la justice romaine, leur humeur farouche adoucie par une nouvelle
discipline inconnue, et leurs débats qu'ils vidaient jusque-là
par les armes terminés par le droit. Ils amenèrent
ainsi Quintilius Varus à faire preuve de la dernière
imprévoyance. Il en vint même à croire qu'il
se trouvait au forum rendant la justice comme préteur urbain
et non plus au centre du territoire Germain à la tête
d'une armée.
Alors un jeune homme noble, courageux, intelligent, d'une
vivacité d'esprit extraordinaire chez un barbare et qui
portait sur son visage et dans ses yeux l'ardeur de son âme,
Arminius, fils de Sigimer chef de cette nation, après nous
avoir fidèlement servis dans la campagne précédente
et avoir même reçu de nous le droit de cité
et le rang de chevalier, trouva dans la faiblesse de notre général
l'occasion de son crime. Il avait pensé, non sans raison,
que personne n'est plus rapidement abattu que celui qui est sans
inquiétude et que la confiance aveugle est la cause la
plus ordinaire des désastres.
Il associe à ses projets, d'abord quelques amis puis
un plus grand nombre. Il leur dit, il leur persuade qu'on peut
écraser les Romains. Aux décisions il joint les
actes et fixe la date de l'embuscade. L'affaire est dénoncée
à Varus par un des hommes de cette nation qui nous resta
fidèle, un noble, Ségeste. Il conseillait de faire
arrêter les conjurés mais déjà les
destins étaient plus forts que la volonté de Varus
et avaient émoussé la pénétration
de son esprit. Car il en est ainsi : souvent un dieu égare
l'esprit de celui dont il veut changer la fortune et fait en sorte,
par un effet déplorable, que le malheur qui survient paraît
mérité et que la mauvaise chance devient un crime.
Ainsi Varus répond à Ségeste qu'il ne croit
pas à ce complot et déclare que les marques de bienveillance
que les Germains lui témoignent s'expliquent par les services
qu'il leur a rendus. Après cet avertissement, Varus n'eut
pas le temps d'en recevoir un second.
CXIX. - Les circonstances de cet affreux désastre qui
fut, après la défaite de Crassus chez les Parthes,
le plus grave qu'un peuple étranger eût infligé
aux Romains, nous essaierons nous aussi, après tant d'autres,
de les exposer en détail dans un ouvrage plus étendu.
Nous ne devons ici le déplorer qu'en peu de mots. Cette
armée était de toutes la plus courageuse et parmi
les troupes romaines elle se distinguait par sa discipline, sa
vigueur et son expérience de la guerre. Mais l'apathie
de son chef, la perfidie de l'ennemi, l'injustice du sort l'accablèrent
à la fois. Les soldats ne furent pas même autorisés
à profiter de l'occasion de combattre ou de tenter une
sortie, sauf dans des conditions défavorables et moins
qu'ils ne l'eussent voulu, puisque certains d'entre eux furent
durement punis pour avoir fait usage de leurs armes et montré
leur courage de Romains. Des forêts, des marécages,
des embuscades les entouraient de tous côtés et ils
furent tués jusqu'au dernier par ces mêmes ennemis
qu'ils avaient toujours égorgés comme un bétail
et dont la vie et la mort dépendaient de leur colère
ou de leur pitié.
Varus montra plus de courage pour mourir que pour combattre
: imitant son père et son aïeul, il se perça
de son épée. L'exemple que donna le préfet
du camp, Lucius Eggius, fut aussi noble que fut honteux celui
que donna son collègue Ceionius. En effet, alors que la
plus grande partie de l'armée avait succombé dans
la lutte, Ceionius proposa de se rendre, préférant
mourir dans les supplices que dans la bataille. De son côté
le lieutenant de Varus, Vala Numonius, homme par ailleurs honnête
et doux, donna l'exemple le plus funeste : il s'enfuit avec la
cavalerie, laissant seule l'infanterie et essaya de gagner le
Rhin avec ses escadrons; mais le destin vengea ce crime, car Numonius
ne survécut pas à ceux qu'il avait trahis et fut
victime de sa trahison. Les ennemis déchirèrent
sauvagement le corps à demi-brûlé de Varus.
Sa tête fut coupée et portée à Maroboduus
qui l'envoya à Auguste. Elle reçut enfin la sépulture
dans le tombeau de la famille Quintilia.
CXX. - A cette nouvelle, Tibère vole auprès
de son père. Eternel protecteur de l'empire romain, encore
une fois il prend en main sa défense. On l'envoie en Germanie.
Il consolide notre pouvoir sur les Gaules, dispose les armées
et met en état les positions fortifiées puis jugeant
de ce qu'il pouvait faire d'après sa propre puissance et
non d'après l'assurance des ennemis qui menaçaient
l'Italie d'une nouvelle guerre des Cimbres et des Teutons, il
prend les devants et franchit le Rhin avec son armée. Il
porte la guerre chez un adversaire que son père et sa patrie
auraient jugé suffisant de voir contenu. Il pénètre
plus avant, ouvre des routes, ravage les champs, brûle les
maisons, disperse ceux qui résistent et revient à
ses quartiers d'hiver, chargé d'une gloire immense sans
avoir perdu un seul de ceux qu'il avait conduits au delà
du Rhin.
Rendons le témoignage qu'il mérite à
Lucius Asprénatus qui servait comme lieutenant sous les
ordres de son oncle Varus. Grâce au courage et à
l'énergie des deux légions qu'il commandait, il
sauva son armée de cet affreux désastre, puis descendant
en hâte vers les places du Bas-Rhin, il maintint fidèles
les esprits déjà hésitants des peuples qui
habitent de ce côté du fleuve. Certains prétendent
toutefois que, s'il sauva la vie de ses soldats, il mit la main
sur les biens de ceux qui périrent avec Varus, et s'assura
à sa guise l'héritage de l'armée qui fut
massacrée.
Il faut louer aussi le courage du préfet du camp,
Lucius Cædicius et celui des soldats que d'immenses troupes
de Germains cernèrent et assiégèrent avec
lui à Alison. Ils surmontèrent toutes les difficultés
que le manque de tout et la puissance des ennemis rendaient intolérables
et insurmontables et, évitant à la fois toute résolution
téméraire et toute lâche prévoyance,
ils guettèrent l'occasion favorable et s'ouvrirent par
le fer le chemin du retour. Comme on le voit par cet exemple,
c'est bien parce qu'il n'avait pas l'esprit de décision
d'un général et non parce que ses soldats manquaient
de courage que Varus qui était par ailleurs un homme sérieux
et plein d'excellentes intentions, se perdit lui-même avec
la plus belle des armées.
Comme les Germains maltraitaient férocement les prisonniers,
Caldus Cælius, jeune homme bien digne de l'antique noblesse
de sa famille, accomplit une action héroïque : saisissant
les anneaux de la chaîne qui le liait, il s'en frappa la
tête avec tant de force qu'il fit jaillir à la fois
le sang et la cervelle et expira sur-le-champ.
CXXI. - Entré en Germanie, Tibère notre général
se fit remarquer dans les campagnes qui suivirent par le même
courage et le même bonheur qu'auparavant. Lorsque sa flotte
et ses fantassins eurent par leurs expéditions brisé
les forces ennemies, lorsqu'il eut rétabli en Gaule une
situation difficile et calmé par son énergie plutôt
que par le châtiment les troubles que l'irritation du peuple
avait fait éclater à Vienne, Auguste son père
proposa de lui accorder sur toutes les provinces et sur toutes
les armées un pouvoir égal au sien, et le sénat
et le peuple romain en décidèrent ainsi. Il était
absurde, en effet, qu'il n'eût pas sous son autorité
les provinces qu'il protégeait et que celui qui était
le premier à porter secours ne fût pas jugé
digne d'obtenir les premiers honneurs. De retour à Rome,
Tibère obtint ce qui lui était dû depuis longtemps,
mais que les guerres ininterrompues avaient différé,
le triomphe sur les Pannoniens et sur les Dalmates. Qui s'étonnerait
de l'éclat de ce triomphe puisque c'était le triomphe
de César ? Mais qui ne s'étonnerait de la faveur
de la fortune ? Dans son triomphe, on put voir chargés
de chaînes les chefs ennemis les plus illustres qui n'avaient
pas péri, comme on l'avait dit. Nous eûmes le bonheur,
mon frère et moi, d'accompagner César dans son triomphe,
avec les citoyens les plus nobles chargés des plus nobles
récompenses. |
|
DION CASSIUS
Histoire romaine, LVI, 18-24
(Cassius Dio Cocceianus [ca 150-235])
De l'Histoire
romaine
de Dion Cassius, écrivain romain de langue
grecque, on ne trouve guère sur le Net qu'une traduction
anglaise sur LacusCurtius,
le site de Bill Thayer.
La traduction française ci-dessous est empruntée
à la traduction de E. Gros. (DION CASSIUS, Histoire
romaine [traduite avec des notes critiques, historiques,
etc. et le texte grec en regard, collationné sur les
meilleures éditions par E. GROS - Ouvrage continué
par V. BOISSÉE], Paris, Firmin Didot, t. 8, 1866.)
(A noter que E. Gros, dans une note de bas de page, situe
la forêt de Teutberg dans le voisinage de Horn, en Westphalie.)
18. On venait de rendre ces sénatus-consultes,
lorsqu'une nouvelle terrible, venue de la Germanie, empêcha
la célébration des fêtes. Voici, en effet,
ce qui s'était passé pendant ce temps-là
dans la Celtique. Les Romains y possédaient quelques régions,
non pas réunies, mais éparses selon le hasard de
la conquête (c'est pour cette raison qu'il n'en est pas
parlé dans l'histoire); des soldats y avaient leurs quartiers
d'hiver, et y formaient des colonies; les barbares avaient pris
leurs usages, ils avaient des marchés réguliers
et se mêlaient à eux dans des assemblées pacifiques.
Ils n'avaient néanmoins perdu ni les habitudes de leur
patrie, ni les mœurs qu'ils tenaient de la nature, ni le
régime de la liberté, ni la puissance que donnent
les armes. Aussi, tant qu'ils désapprirent tout cela petit
à petit et, pour ainsi dire, en suivant la route avec précaution,
ce changement de vie ne leur était pas pénible et
ils ne s'apercevaient pas de cette transformation; mais, lorsque
Quintilius Varus, venant avec l'imperium prendre le gouvernement
de la Germanie et administrer le pays, se hâta de faire
des réformes trop nombreuses à la fois, qu'il leur
commanda comme à des esclaves, et qu'il leva des contributions
comme chez un peuple soumis, les Germains ne le supportèrent
pas. Cependant, bien que les principaux chefs regrettassent leur
puissance d'auparavant et que le peuple préférât
son état habituel à la domination étrangère,
ils ne se révoltèrent pas ouvertement, parce qu'ils
voyaient les Romains en grand nombre, tant sur les bords du Rhin
que dans leur propre pays : accueillant Varus, comme s'ils étaient
décidés à exécuter tous ses ordres,
ils l'attirèrent, loin du Rhin, dans le pays des Chérusques,
près du Veser; là, par des manières toutes
pacifiques et par les procédés d'une amitié
fidèle, ils lui inspirèrent la confiance qu'il pouvait
les tenir en esclavage, même sans le secours de ses soldats.
19. Varus donc, au
lieu d'avoir ses légions réunies, comme cela se
doit faire en pays ennemi, les dispersa en nombreux détachements,
sur la demande des habitants les plus faibles, sous prétexte
de garder certaines places, de s'emparer de brigands ou de veiller
à l'arrivée des convois de vivres. Les principaux
conjurés, les chefs du complot et de la guerre, furent,
entre autres, Arminius et Sigimère, qui avaient avec Varus
des rapports continuels et souvent partageaient sa table. Cependant,
tandis que Varus est plein de confiance, et que, loin de s'attendre
à aucun malheur, il refuse d'ajouter foi à aucun
de ceux qui soupçonnent ce qui se passe et l'avertissent
de se tenir sur ses gardes, que même il les repousse comme
des gens qui s'alarment sans sujet et calomnient les Germains,
quelques-unes des peuplades lointaines se soulèvent à
dessein les premières, afin qu'en se dirigeant contre elles,
il soit plus aisé à surprendre dans sa marche à
travers un pays qu'il croit ami, et que, la guerre n'éclatant
pas sur tous les points à la fois, il ne se tienne pas
sur ses gardes. C'est ce qui arriva. Ils l'accompagnèrent
à son départ et ne le suivirent pas dans sa marche,
sous prétexte de lui procurer des auxiliaires et d'aller
promptement à son secours. Ils se réunirent aux
troupes qu'ils avaient disposées dans un lieu favorable,
et, massacrant chacun les soldats qu'ils avaient eux-mêmes
auparavant appelés chez eux, ils rejoignirent Varus déjà
engagé dans des forêts inextricables. Là,
ils se déclarèrent tout à coup ennemis au
lieu de sujets, et se livrèrent à un grand nombre
d'actes affreux.
20. Les montagnes étaient
coupées de vallées nombreuses et inégales,
les arbres étaient tellement serrés et d'une hauteur
tellement prodigieuse, que les Romains, même avant l'attaque
des ennemis, étaient fatigués de les couper, d'y
ouvrir des routes et de les employer à construire des ponts
partout où il en était besoin.
Ils menaient avec
eux un grand nombre de chariots et de bêtes de somme, comme
en pleine paix; ils étaient suivis d'une foule d'enfants
et de femmes, ainsi que de toute la multitude ordinaire des valets
d'armée : aussi marchaient-ils sans ordre. Une pluie et
un grand vent, qui survinrent dans ce même temps, les dispersèrent
davantage encore; le sol, devenu glissant auprès des racines
et auprès des troncs, rendait les pas mal assurés;
la cime des arbres, se brisant et se renversant, jeta la confusion
parmi eux. Ce fut au milieu d'un tel embarras que les barbares,
grâce à leur connaissance des sentiers, fondant subitement
de toute part sur les Romains à travers les fourrés,
les enveloppèrent : ils les attaquèrent d'abord
de loin à coup de traits, puis, comme personne ne se défendait
et qu'il y en avait un grand nombre de blessés, ils avancèrent
plus près; les Romains, en effet, marchant sans aucun ordre,
pêle-mêle avec les chariots et les hommes sans armes
et ne pouvant se rallier aisément, étant d'ailleurs
moins nombreux que les ennemis qui les attaquaient, éprouvaient
des maux innombrables sans en rendre.
21. Là, ayant
rencontré un endroit favorable, autant du moins que le
permettait une montagne couverte de forêts, ils y posèrent
leur camp; puis, après avoir, partie brûlé,
partie abandonné la plupart de leurs chariots et ceux de
leurs bagages qui ne leur étaient pas absolument indispensables,
ils se mirent en route, le lendemain, dans un meilleur ordre,
afin d'atteindre un lieu découvert; cependant ils ne partirent
pas sans avoir versé bien du sang.
En effet, après avoir quitté ce campement, ils tombèrent
de nouveau dans des forêts et eurent à repousser
des attaques, ce qui ne fut pas la moindre cause de leurs malheurs.
Réunis dans un lieu étroit, afin que cavaliers et
fantassins à la fois pussent charger l'ennemi en colonnes
serrées, ils eurent beaucoup à se heurter entre
eux et contre les arbres.
Le troisième
jour après leur départ, une pluie torrentielle,
mêlée à un grand vent, étant de nouveau
survenue, ne leur permit ni d'avancer, ni de s'arrêter avec
sûreté, et même leur enleva l'usage de leurs
armes; ils ne pouvaient, en effet, se servir ni de leurs arcs,
ni de leurs javelots, ni de leurs boucliers à cause de
l'humidité. Ces accidents étaient moins sensibles
pour les ennemis, la plupart légèrement armés
et libres d'avancer ou de reculer. En outre, les barbares, dont
le nombre s'était considérablement accru (beaucoup
de ceux qui auparavant se contentaient de regarder s'étaient
joints à eux, en vue surtout du butin), entouraient aisément
et massacraient les Romains dont le nombre, au contraire (ils
avaient perdu beaucoup des leurs dans les précédents
combats), était déjà bien diminué;
en sorte que Varus et les principaux chefs (ils étaient
blessés), craignent d'être pris vifs ou mis à
mort par des ennemis implacables, osèrent une action, affreuse
il est vrai, mais nécessaire : ils se donnèrent
eux-mêmes la mort.
22. A cette nouvelle,
personne, même celui qui en avait la force, ne se défendit
plus; les uns imitèrent leur chef, les autres, jetant leurs
armes, se laissèrent tuer par qui le voulut; car la fuite,
quelque désir qu'on eût de s'échapper, était
impossible. Hommes et chevaux, tout était impunément
taillé en pièces ...
Il y a ici une lacune dans le manuscrit de Dion Cassius, que
Gros recoupe avec Zonaras, et complète :
Ils furent donc impunément taillés en pièces,
et les barbares se rendirent maîtres de toutes les places
fortes, à l'exception d'une, toutefois, qui les arrêta
de façon qu'ils ne passèrent pas le Rhin et ne
firent pas d'incursions dans la Gaule. Ils ne parvinrent pas,
non plus, à réduire la place, attendu qu'ils ne
connaissaient pas l'art des sièges, et que les Romains
avaient un grand nombre d'archers dont les coups portaient le
ravage et la mort dans leurs rangs. Ensuite, instruits que les
Romains avaient des garnisons sur le Rhin, et que Tibère
marchait contre eux à la tête d'un détachement
formidable, la plupart abandonnèrent l'attaque de la
place, tandis que ceux qui restèrent s'éloignèrent
pour ne pas être incommodés par les sorties subites
des assiégés, se saisirent des routes, dans l'espoir
de prendre l'ennemi par le manque de vivres. Quant aux Romains
qui étaient dans l'intérieur de la place, tant
qu'ils eurent des provisions, ils tinrent bon, s'attendant à
être secourus; mais, comme ils ne recevaient d'aide de
personne et qu'ils étaient pressés par la famine,
ils sortirent à la faveur d'une nuit d'orage (ils étaient
peu de soldats, beaucoup même n'avaient pas d'armes),
traversèrent les premières et les secondes gardes
des barbares, et ne furent découverts qu'arrivés
aux troisièmes. Tous...
... ils franchirent
les premières et les secondes gardes des ennemis; mais,
arrivés aux troisièmes, les femmes et les enfants,
à cause de la fatigue, de la peur, des ténèbres
et du froid, appelant sans cesse ceux qui étaient dans
la force de l'âge, les firent découvrir. Ils auraient
tous péri ou ils eussent été faits prisonniers,
si les barbares ne s'étaient arrêtés à
piller. Grâce à cette circonstance, les plus robustes
s'échappèrent bien loin, et les trompettes qui étaient
avec eux s'étant mis à sonner la charge (la nuit
était survenue et on ne les voyait pas) firent croire aux
ennemis que c'était Asprénas qui avait envoyé
des renforts.
Dès lors les
barbares renoncèrent à poursuivre les Romains au
secours desquels, quand il fut instruit de ce qui se passait,
Asprénas vint effectivement. Dans la suite, quelques-uns
des captifs rentrèrent dans leurs foyers, moyennant une
rançon payée par leurs parents, à qui cette
permission fut accordée à la condition que les captifs
resteraient en dehors de l'Italie (1).
Mais cela n'eut lieu que plus tard.
23. Auguste, en apprenant
la défaite de Varus, déchira ses vêtements,
au rapport de plusieurs historiens, et conçut une grande
douleur de la perte de son armée (2),
et aussi parce qu'il craignait pour les Germanies et pour les
Gaules, et, ce qui était le plus grave, parce qu'il se
figurait voir ces nations prêtes à fondre sur l'Italie
et sur Rome elle-même (3),
et qu'il ne restait plus de citoyens en âge (4)
de porter les armes ayant quelque valeur, et que ceux des alliés
dont le secours eut été de quelque utilité
avaient souffert. Néanmoins il prit toutes les mesures
qu'exigeait la circonstance; et comme aucun de ceux qui avaient
l'âge de porter les armes ne voulait s'enrôler, il
les fit tirer au sort, et le cinquième parmi ceux qui n'avaient
pas encore trente-cinq ans, le dixième parmi ceux qui étaient
plus âgés, était, par suite de ce tirage,
dépouillé de ses biens et noté d'infamie.
Enfin, comme, malgré cela, beaucoup refusaient encore de
lui obéir, il en punit plusieurs de mort. Il enrôla
ainsi par la voie du sort le plus qu'il put de vétérans
et d'affranchis, et se hâta de les envoyer immédiatement
en Germanie rejoindre Tibère. Comme il y avait à
Rome un grand nombre de Gaulois et de Germains, les uns voyageant
sans songer à rien, les autres servant dans les gardes
prétoriennes (5),
il craignit qu'ils ne formassent quelque complot, et il envoya
les derniers dans des îles, tandis qu'à ceux qui
n'avaient pas d'armes, il enjoignait de sortir de la ville.
24. Telles furent
les dispositions alors adoptées par Auguste; de plus aucune
des fêtes instituées par les lois n'eut lieu, et
les jeux ne furent pas célébrés; ensuite,
à la nouvelle que quelques soldats avaient survécu
à la défaite, que les Germanies étaient contenues
par des garnisons et que l'ennemi n'avait même pas osé
venir sur les bords du Rhin, il se remit de son trouble et provoqua
une délibération sur les événements.
Un désastre si grand et frappant tant de monde à
la fois semblait n'être arrivé que par un effet de
la colère divine,et les prodiges survenus avant et après
la défaite lui faisaient craindre quelque vengeance des
dieux. Le temple de Mars, dans le champ qui porte son nom, avait
été frappé de la foudre; et de nombreux escarbots,
qui avaient poussé leur vol jusque dans Rome, avaient été
dévorés par des hirondelles, les sommets des Alpes
avaient paru s'entrechoquer et faire jaillir trois colonnes de
feu; le ciel, plusieurs fois, avait semblé s'embraser;
de nombreuses comètes s'étaient montrées
ensemble; on crut voir des lances venir du Nord tomber sur le
camp des Romains; des abeilles construisirent leurs rayons auprès
des autels; en Germanie, une Victoire qui regardait le territoire
ennemi se retourna du côté de l'Italie; enfin, autour
des aigles, dans le camp, les soldats, comme si les barbares eussent
fondu sur eux, se livrèrent un combat sans résultat.
Voila comment se passèrent alors les choses. |
|
TACITE
Annales, I, 61-62
Publius Cornelius Tacitus (54-117), historien romain né
à Interamna en Ombrie (ou à Rome ?). Au Livre
I des Annales (An., I, 61-62), Tacite raconte
la découverte par Germanicus et ses troupes du charnier
constitué par les corps des soldats de Varus abandonnés
sur le champ de bataille. Son récit est basé sur
L'Histoire des guerres de Germanie, un ouvrage perdu
de Pline l'Ancien (23-79 de n.E.) qui avait servi comme officier
de cavalerie en Gaule et en Germanie. Au cours de ce séjour,
Pline avait rencontré et discuté avec des survivants
du désastre de Varus.
Au Livre II des Annales, Tacite narre les événements
de 16 à 19, c'est-à-dire la guerre de représailles
menée par Germanicus contre Arminius et ses alliés
(TAC., An., II, 5-26, 41, 44-46, 88). Nous n'avons pas
jugé utile de les reprendre ici. Enfin, Tacite dans sa
Germanie propose une incroyable mine de renseignements
sur les Germains, à manier avec précaution cependant
car il a tendance à les idéaliser, leur trouvant
les mêmes vertus que celles pratiquées par les
anciens Romains d'autrefois !
On trouvera sur le site de Philippe Remacle les Tables,
les Annales
I et les Annales
II, ainsi que la Germanie.
60. (...) afin de diviser les forces de l'ennemi, il
(6)
envoie Cæcina vers l'Ems, par le pays des Bructères,
avec quarante cohortes romaines (7).
Le préfet Pédo conduit la cavalerie par les confins
de la Frise : Germanicus lui-même s'embarqua sur les lacs
avec quatre légions; et bientôt l'infanterie, la
cavalerie et la flotte se trouvèrent réunies sur
le fleuve marqué pour le rendez-vous. Les Chauques offrirent
des secours et furent admis sous nos drapeaux. Les Bructères
mettaient en cendres leur propre pays. L. Stertinius, envoyé
par César [Germanicus] avec une troupe légèrement
équipée, les battit; et, en continuant de tuer et
de piller, il retrouva l'aigle de la dix-neuvième légion,
perdue avec Varus. Ensuite l'armée s'avança jusqu'aux
dernières limites des Bructères, et tout fut ravagé
entre l'Ems et la Lippe, non loin de la forêt de Teutoburg,
où, disait-on, gisaient sans sépulture les restes
de Varus et de ses légions.
61. César [Germanicus] éprouva donc le
désir de rendre les derniers honneurs aux soldats et aux
chefs; et toute l'armée présente fut saisie d'une
émotion douloureuse en songeant à leurs proches,
à leurs amis, enfin aux chances de la guerre et à
la destinée des humains. Cæcina est envoyé
en avant pour sonder les profondeurs de la forêt, et construire
des ponts ou des chaussées sur les marécages du
sol et les terrains d'une solidité trompeuse; puis l'on
pénètre dans ces lieux pleins d'images sinistres
et de lugubres souvenirs. Le premier camp de Varus, à sa
vaste enceinte, aux dimensions de sa place d'armes, annonçait
l'ouvrage de trois légions. Plus loin un retranchement
à demi ruiné, un fossé peu profond indiquaient
l'endroit où s'étaient arrêtés leurs
débris, déjà faibles. Au milieu de la plaine,
des ossements blanchissants, épars ou amoncelés,
suivant qu'on avait fui ou combattu. A côté, par
terre, des morceaux d'armes et des membres de chevaux. Des têtes
humaines pendaient au tronc des arbres. Dans les bois voisins,
les autels barbares où furent immolés les tribuns
et les centurions primipiles. Et les soldats qui survivaient à
ce désastre, ayant échappé à la mort
où s'étant échappés de leur prison,
montraient la place où périrent les légats,
où les aigles furent enlevées. «Ici Varus
reçut une première blessure; là son bras
malheureux, tourné contre lui-même, le délivra
de la vie.» Ils disaient «sur quel tribunal
Arminius harangua son armée, combien il dressa de gibets,
fit creuser de fosses pour les prisonniers; par quelles insultes
son orgueil outragea les enseignes et les aigles».
62. Ainsi une armée romaine présente sur le
théâtre du désastre recueillait, après
six ans, les ossements de trois légions; et, sans savoir
s'ils couvraient de terre la dépouille d'un proche ou d'un
étranger, animés contre l'ennemi d'une colère
nouvelle, et la tristesse dans le cœur aussi bien que la
vengeance, ils ensevelissaient tous ces restes comme ceux d'un
parent ou d'un frère. On éleva un tombeau, dont
César posa le premier gazon; pieux devoir, particulièrement
agréable aux morts et par lequel il s'associait à
la douleur des vivants. Cet acte ne fut point approuvé
de Tibère : soit que Germanicus ne pût rien faire
qu'il n'y trouvât du crime, soit que l'image des guerriers
massacrés et privés de sépulture lui parût
capable de refroidir l'armée pour les combats et de lui
inspirer la crainte de l'ennemi; soit, enfin, qu'il pensât
qu'un général, revêtu de l'augurat et des
fonctions religieuses les plus antiques, ne devait approcher ses
mains d'aucun objet funèbre (8). |
|
En guise d'épitaphe...
Il nous plaît de rapprocher du texte de Tacite, ces quelques
lignes de Pierre Schoendoerffer, préparant son film Dien
Bien Phu, et revenant sur le site de la bataille à
laquelle il avait participé comme «cinéaste
aux armées».
«J'y suis retourné avec ma famille. Il pleuvait.
Il y avait des zones sur les collines où l'herbe n'avait
pas repoussé depuis trente-sept ans. On voyait, au milieu
des grenades rouillées et des obus non éclaté,
une multitude de choses noires à fleur de terre. C'étaient
les semelles de caoutchouc des soldats qui avaient été
là, qui étaient morts là. En fonction de
la semelle, on pouvait reconnaître si c'était un
Viêt-minh, un tirailleur, un parachutiste, un légionnaire...
Vous ramassiez une poignée de terre et vous aviez de
la ferraille dans les mains, parfois des débris humains,
que le soldat vietnamien qui nous accompagnait emportait pour
mettre dans un ossuaire.. Et il y avait ces bouquets de bambous
flamboyants, de quarante mètres de hauteur, qui avaient
poussé entre les collines, sur les restes de tous ces
soldats morts, ces feuilles qui frémissaient au vent.
Je n'avais aucun souvenir de ces bambous - et là il y
en avait partout où nous nous étions battus. C'était
magnifique. (...) Je suis monté sur Dominique
2, je suis redescendu, puis je suis allé vers Eliane
1, qui pour moi reste un des endroits les plus épouvantables
de Diên Biên Phu. Eliane 1, c'était le charnier,
l'horreur, parce qu'il y avait deux faces où ni les Français
ni les Vietnamiens ne pouvaient aller et où les corps
ont donc pourri pendant cinquante-sept jours et cinquante-sept
nuits... J'avais le sentiment de cette armée morte, proche
à me toucher la peau. Et là, dans la nuit étoilée,
je leur ai dit que c'était pour eux que je faisais ce
que je faisais et qu'il fallait qu'ils m'aident. J'ai parlé
à haute voix et j'étais tout seul.
Pierre SCHOENDOERFFER (9)
|
NOTES :
(1) «Cette circonstance du rachat
des captifs n'est pas indifférente ici. On connaît
assez les principes des Romains à l'égard des
captifs, principe dont le sénat à donné
un exemple remarquable surtout dans la seconde guerre Punique,
ou il préféra affranchir et armer des esclaves,
bien qu'il put racheter à moins de frais les soldats
captifs d'Hannibal» (note de E. Gros). - Retour
texte
(2) «La douleur et la crainte
qu'inspira ce désastre à Auguste sont assez connues;
il suffira de renvoyer à SUÉTONE, 22» (note
de E. Gros). - Retour texte
(3) «Si Tibère (SUÉTONE,
17) n'eut pas, avant la catastrophe de Varus, soumis l'Illyrie,
il est hors de doute que les Germains victorieux se seraient
joints aux Pannoniens» (note de E. Gros). - Retour
texte
(4) «L'âge, chez les Romains,
était de dix-sept à quarante ans; le citoyen qui
avait servi dix ans dans la cavalerie, ou vingt dans l'infanterie,
pouvait honorablement demander une exemption» (note de
E. Gros). - Retour texte
(5) «Il faut rapprocher de ce
passage celui de SUÉTONE (49), où il est dit qu'Auguste,
après la défaite de Varus, licencia la compagnie
de Germains qui lui avait jusqu'alors servi de garde»
(note de E. Gros).
Faisons tout de même remarquer que, troupe privée
recrutée parmi les Bataves, les gardes du corps germaniques
ne faisaient pas partie des prétoriens, lesquels étaient
recrutés dans la petite noblesse italienne. Au nombre
de 100 ou 500, ces corporis custodes dissous en 9 furent
rapidement reconstitués avant 14. C'est Caligula qui
les militarisera en les faisant passer sous le contrôle
du préfet du prétoire (cf. Y. LE BOHEC,
L'Armée romaine, Picard, 2e éd., 1998,
p. 23). - Retour texte
(6) Julius Cæsar Germanicus.
- Retour texte
(7) Les quatre légions du Rhin
inférieur (N.d. Henri BORNECQUE). - Retour
texte
(8) Il s'exposait par là à
une souillure (N.d. Henri BORNECQUE). - Retour
texte
(9) P. SCHOENDOERFFER, Diên
Biên Phu. 1954/1992. De la bataille au film, Editions
Lincoln - Fixot, 1992, pp. 125-126. - Retour
texte
|
| |
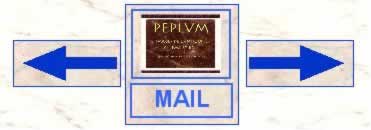 |
|