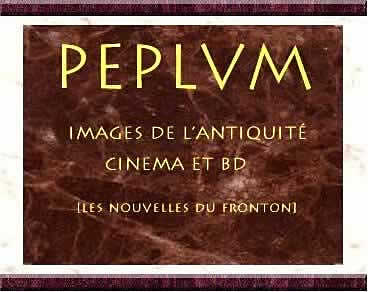 |
| |
| |
De La Chute de l'Empire romain
à Gladiator
Page 8/16
|
|
| |
|
| |
8.4.
Armes des gladiateurs
Les ouvrages de référence ne sont - bien
entendu - pas d'accord entre eux, d'autant que nombre d'auteurs
se sont de préférence penchés sur l'aspect
socio-politique de la gladiature, sans vraiment s'interroger sur
les techniques, qui se déduisent des documents archéologiques.
Comparons, par exemple, le Dictionnaire des Antiquités
(1841) de M.N. Bouillet et le petit livre de Marcel Brion, La
révolte des gladiateurs (1952).
8.4.1. Mirmillons
Pour le premier, le mirmillon (ou gallus, «gaulois»)
est armé d'un bouclier et d'une faux, et porte un poisson
sur le haut de son casque; pour le second auteur, le mirmillo
«était armé d'une lance. Il portait un
casque, un bouclier gaulois, mais sa poitrine et ses jambes restaient
nues, à la différence du thræx (ou
thrax), couvert d'une cuirasse et de jambières, muni
d'une épée et d'une lance.» Pour Bouillet,
au contraire, les thraces «avaient une espèce
de coutelas ou de cimeterre, comme les habitants de la Thrace,
d'où ils avaient pris leur nom.» Le poignard
thrace en question est la sica, dont la lame recourbée
ou «cassée» à angle obtus forme une
espèce de crochet qui sert à agripper le bord du
grand scutum de l'adversaire, à s'insinuer derrière
sa défense et à lui balafrer le torse, la lame étant
à deux tranchants, effilés comme des rasoirs (1). |
| |
| 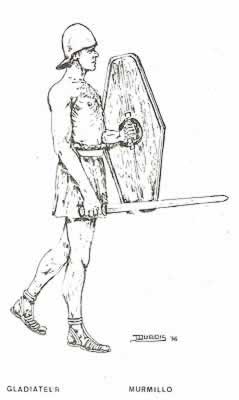
Pour Jacques Dubois (2),
le mirmillon ou murmillo est le même
que le gallus, le Gaulois demi-nu qui combat avec
ses armes nationales. Mais c'est aussi aux Gaulois que les
légionnaires romains ont emprunté la cotte
de maille : le mirmillon serait alors à rapprocher
de la catégorie des cuirassés - contra-retiarius,
scissor, crupellarius... ? |
|
| |
Il semble que le «mirmillon»
soit issu du gaulois. Un poisson de métal
- un morme - s'ajoute au sommet de son casque, ainsi qu'un grillage
pour protéger le visage (sous la république, les
casques de gladiateurs ne comportent pas de protection faciale
[3]).
Pas de protections aux jambes.
Il est l'adversaire obligé du rétiaire, qui essaie
de pêcher le poisson avec son filet ! A noter que le poisson
en cimier de casque n'est connu que par les textes, sans être
confirmé par l'iconographie ou des pièces d'équipement
retrouvées
(Eric Teyssier (Ars Maiorum — Nîmes), qui s'apprête
à sortir chez Actes Sud, pour avril 2009, un nouvel ouvrage
sur la gladiature fondé sur 1.600 images antiques répertoriées,
400 inscriptions et presque autant de passages consacrés
à ce sujet dans la littérature antique, le tout
éclairé par l'expérimentation des techniques
de combat, a bien voulu nous faire part de ses commentaires. «Le
problème des affirmations sur les gladiateurs reste qu'elles
s'appuient sur des a priori qui ne se préoccupent
jamais de la validité des sources. Certes, le mirmillon
qui apparaît sous la calame de Cicéron provient probablement
du Gaulois mais cela ne l'empêche pas d'évoluer ensuite
en adoptant un bouclier qui procède plutôt de celui
du samnite.»
Extrait de la HDR d'E. Teyssier (décembre 2008) : «Le
mirmillon constitue un gladiateur dont les origines demeurent
obscures. Le fait qu'il ait été opposé à
trois gladiateurs différents, le thrace, le rétiaire
et l'hoplomaque a également contribué à opacifier
son identification. C'est sans doute pour cela que le mirmillon
constitue l'une des armaturæ les plus malmenée
dans les descriptions des historiens modernes.
En se fondant sur cette seule chanson rapportée par Festus
la quasi totalité des auteurs associent le mirmillon au
«proto-gladiateur» gaulois. Cette chanson, provocante
que le rétiaire chante à l'encontre de son adversaire
proclame : «Où cours-tu gaulois, ce n'est pas
à toi que j'en veux : c'est à ton poisson !»
(«Quid me fugis galle, non te peto, piscem petto»
— FESTUS, De la signification des mots, XVI, retiarius).
Ce passage étant pratiquement cité par tous les
historiens de la gladiature, cette allusion de Festus est devenue
un truisme, sans que le texte n'ait été réellement
soumis à un regard critique, ni confronté aux autres
sources dont nous disposons. En premier lieu, il peut paraître
étrange qu'un rétiaire «chante» en plein
combat. Qui peut l'entendre ? S'adresse t-il à la foule
? Mais le public, placé sur les gradins à des dizaines
de mètres des combattants, est plus occupé à
crier ses encouragements à son favori qu'à écouter
sa chansonnette. Chante-t-il à l'intention du gladiateur
qu'il combat ? Mais que l'adversaire du rétiaire soit un
mirmillon ou un secutor, celui-ci est forcement protégé
par un casque qui enveloppe sa tête. Avec cette protection,
doublée d'une calotte de peau ou de toile, sur les oreilles
et avec la rumeur sourde des cris du public, il est certain que
le gladiateur ne peut rien entendre d'articulé. Pourtant
ces paroles ont trop souvent suffi pour affirmer de manière
définitive que les rétiaires ont systématiquement
pour adversaire le mirmillon, que celui-ci dérive de l'armatura
gauloise et qu'il porte toujours un poisson sur le casque,
d'où proviendrait le nom mirmillon. Ces affirmations méritent
d'être reprises en revenant aux sources littéraires,
iconographiques et épigraphiques et en les confrontant
aux réalités du combat.
Pour ce qui est de la question du casque orné d'un
poisson, aucun des équipements de gladiateur parvenus jusqu'à
nous, ni aucune des représentations connues ne figure un
poisson sur la tête d'un gladiateur. Le casque orné
d'un poisson porté par le mirmillon du célèbre
tableau de Gérôme Pollice verso a, quant à
lui, été «forgé» de toutes pièces
par l'artiste, précisément d'après la chanson
de Festus.
Ce tableau pompier étant systématiquement utilisé
pour illustrer les ouvrages traitant de gladiature, il semble
considéré par beaucoup comme une véritable
source très souvent donnée en exemple . D'un
point de vue symbolique, le poisson pourrait certes se justifier
par rapport au filet du rétiaire. Néanmoins, le
simple bon sens permet de comprendre qu'un tel ornement, porté
au combat, donnerait un énorme avantage au rétiaire.
Ce dernier pourrait prendre à coup sûr la tête
de son adversaire dans les mailles de son filet grâce aux
aspérités qu'offre cette protubérance. Un
tel déséquilibre dans l'équipement ne s'observe
jamais dans la gladiature pour la simple raison qu'il enlèverait
tout intérêt au spectacle et au suspens qui constituent
justement la raison d'être de ces combats. En fait, cette
vision des choses est caractéristique de nombreux auteurs
modernes trop prompts à utiliser certaines sources pour
les faire coller à des affirmations anciennes sans réfléchir
sur l'aspect simplement pratique des choses.
|
| |
| 
Statuette en bronze de 13
cm, représentant un mirmillon — California Institute
of World Archaeology |
|
| |
La force de cette idée
reçue est telle qu'elle est sans doute à l'origine
d'une supercherie dans le cas d'une statuette de mirmillon en
bronze conservée aux Etats-Unis (voir ci-dessus). Le casque
représenté sur cet objet est cohérent puisque
directement inspiré par le modèle conservé
au Pergamon Museum de Berlin. La manica et le glaive sont
également à peu près conformes à la
réalité à première vue. Pourtant à
y regarder de plus près, l'arme est trop affilée
par rapport aux autres modèles connus de statuettes. De
plus, aucune sangle de vient attacher la manica au torse.
Surtout, les «créateurs» de cette pièce
ont jugé bon d'affubler le sommet du casque d'un poisson.
Même si la forme de ce dernier est un peu grotesque, sa
présence devait sembler indispensable à la bonne
identification de ce gladiateur. Pour parachever l'incohérence,
le poisson en question n'est pas placé sur le cimier métallique
du casque mais sur le panache qui surmonte ce dernier. On peut
donc se poser la question de savoir comment ce poisson pourrait
tenir sur ces plumes ?
Cet exemple, qui n'est certainement pas antique, est bien caractéristique
d'une vision de la gladiature qui fonctionne davantage par fidélité
à certains clichés plutôt qu'en fonction des
réalités techniques et iconographiques.
Si le poison ne peut pas être placé systématiquement
sur le casque de gladiateurs combattants, il n'est pas exclu que
ce type de décoration ait pu apparaître ponctuellement
dans l'ornementation d'un casque de parade. Ceci expliquerait
l'origine de cette chanson qui a peut-être été
composée à l'occasion d'une pompa mais cette
source peut difficilement être considérée
comme fiable pour la compréhension du mirmillon au combat.
Plus vraisemblablement encore, le poisson, ou plutôt le
dauphin (le dauphin est considéré comme un porte
bonheur : ARTÉMIDORE, Onirocriticon, II, 16), constitue
un élément de décor du casque qui n'est pas
forcément sur le cimier mais sur la bombe. Ce type de décoration
est ainsi incisé sur un casque de mirmillon de Pompéi,
mais on le retrouve également en décor repoussé
sur la calotte d'un casque de thrace et sur le galerus d'un rétiaire.
Les équipements de gladiateurs provenant de Pompéi
comportent donc bien plusieurs décors au «poisson»,
mais si ce dernier constitue un élément de la symbolique
et du décor gladiatorien, il n'est en rien l'apanage des
mirmillons comme cela a souvent été affirmé.
La réalité du mirmillon semble donc différente
de celle déduite de cette seule chanson.»
«(...) Bref au risque de nous répéter
— ajoute E. Teyssier — il faut rappeler que la gladiature
est un phénomène qui dure au moins sept siècles
et que les appréciations fondées sur un ou deux
exemples qui ont parfois trois siècles d'écart ne
permettent pas de clarifier les choses.» E. Teyssier
rejette donc formellement notre hasardeuse hypothèse selon
laquelle la métaphore du poisson aurait pu faire référence
aux écailles des protections, notamment la manica.
Dont acte.)
|
| |
| 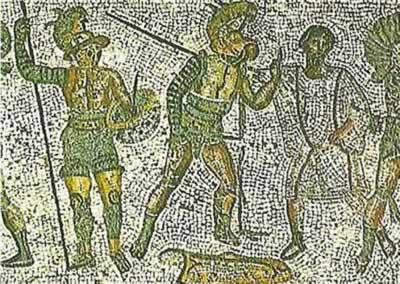
Détail de la mosaïque de Zliten.
Un hoplomaque vainqueur d'un mirmillon |
|
| |
8.4.2. Thraces
et hoplomaques
Un gladiateur lourd, de type scutarii, est nécessairement
opposé à un gladiateur léger, parmularii
ou rétiaire. Le thrace est un gladiateur léger
ou semi-lourd, un parmularii équipé d'un
petit bouclier carré, d'où sa paire de jambières
(il n'en a pas toujours), mais ne porte pas de cuirasse, sauf
le manchon (manica) qui couvre le bras droit.
Toutefois, il semble bien qu'il soit parfois équipé
d'une lance : d'aucuns spécialistes voudraient ranger ce
lancier parmi les mirmillons (Bouillet, supra) ou les hoplomaques
(Teyssier & Lopez), combattants lourds. Mais comme ses autres
armes sont celles du thrace, on considère parfois à
côté du thrace «A» classique (4),
le thrace «B» æquimanus («ambidextre»,
car il manie deux armes), c'est-à-dire l'hoplomaque.
(Remarque d'Eric Teyssier : «Pour les notions de «lourd-léger»
il importe de balayer cette dichotomie qui provient de la boxe
anglaise du XIXe s. mais n'a aucun sens dans l'Antiquité.
Même le rétiaire que l'on pourrait classer ainsi
a commencé sa carrière avec un casque, une cote
de maille et deux grandes jambières... vous verrez cette
image étonnante dans mon bouquin... Toutes les images (rares
au demeurant) de gladiateurs gaulois (ils disparaissent sous Auguste)
les montrent par contre torse nu... Les protections à écailles
existent bien chez les gladiateurs mais elles sont exclusivement
l'apanage des equites (gladiateurs à cheval) au
Ier s. av. n.E. Ensuite ils portent une tunique...»). |
| |
|
Thrace (thræx)
et hoplomaque (oplomachus) selon Jacques Dubois.
Il existe de nombreuses variantes au casque du thrace. Sur
certaines représentations il porte un simple casque
à large bord, une sorte de petit chapeau qui laisse
le visage découvert. Le plus souvent, il portera
un casque fermé, avec une crête figurant un
griffon. Ici, le casque-griffon est d'un modèle exceptionnel,
avec des ailes, représenté sur un manche de
couteau en os. Il se reconnaît plus sûrement
à son petit bouclier carré, ses ocrea
hautes, les fascies sur les cuisses et son coutelas
recourbé, la sica. J. Dubois range l'hoplomaque
parmi les grands boucliers à cause de son nom qui
semble faire référence aux hoplites grecs,
mais cette interprétation est très contestable... |
| 
Parmularius contre scutarius
: un thrace au petit bouclier contre un mirmillon
au bouclier long (reconstitutions ACTA Expérimentation) |
|
| 
Casque de thrace, avec son cimier en
forme de griffon, caractéristique |
|
|
| |
L'hoplomaque, «celui
qui combat contre les grands boucliers (hoplon)»,
combat mirmillons et thraces. Comme le thrace il a un casque,
une paire d'ocrea hautes et un petit bouclier rond. Mais
son arme est la lance et la dague, non la sica.
|
| |
|
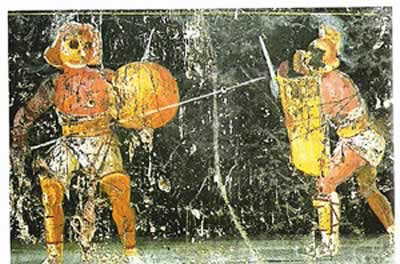
Hoplomaque et mirmillon, selon E. Teyssier
et B. Lopez
|
|
| |
8.4.3. Samnites
On sait finalement peu de choses du samnite et du mirmillon. Le
«samnite» (samnes) apparaît en
Campanie vers 310, suite à la défaite de ce peuple
dont les armes confisquées servent à équiper
des gladiateurs, probablement les prisonniers de guerre samnites
eux-mêmes. Les Romains empruntent ces gladiateurs samnites
aux Campaniens, leurs alliés. Ils portent le galea
(casque à larges bords, décoré de plumes
et panaches), le scutum quadrangulaire (à l'origine,
le bouclier samnite se rétrécit vers le bas, en
goulot de bouteille), une ocrea (jambière) à
la jambe gauche, celle qui s'avance sous le bouclier. L'abdomen
est protégé par un large ceinturon, le balteus,
et le bras droit par un manchon de cuir, ou d'écaille ou
de mailles de métal (manica). Il est armé
d'un glaive court (gladius), parfois remplacé par
une lance. Le but est de protéger les parties du corps
où les blessures sont handicapantes, et de laisser nues
celles où elles sont paralysantes (bras, jambes, poitrine).
8.4.4. Gaulois
Vers la même époque que le «samnite»,
est apparu le «gaulois» (gallus) qui
a lui aussi conservé ses armes nationales (casque, bouclier
probablement hexagonal ou oblong) et la longue épée
celtique à bout arrondi, qui ne frappe que de taille. Une
arme idéale pour trancher les mailles du filet du rétiaire.
8.4.5. Secutors, provocators et hoplomaques
Au début de l'Empire, le «samnite» disparaît
tandis qu'émergent de nouvelles armes : le secutor
et le provocator issus de lui, et enfin l'hoplomaque.
L'hoplomaque est une variante du thrace, mais il a remplacé
la sica, arme courte, par la lance, arme longue : il s'oppose
traditionnellement au thrace. Nous les avons décrits plus
haut.
Déjà connu au temps de Cicéron, le provocator
est identique au samnite sauf l'épée longue, une
spatha qui ne permet que des coups de taille (5.
Il porte une protection de poitrine, un cardiophylax qui
fait songer aux anciens guerriers samnites.
Enfin le secutor - qui «poursuit» le rétiaire,
lequel combat en fuyant et harcelant - tend à remplacer
le mirmillon contre son adversaire naturel, le pêcheur de
poissons. Le handicap du lourd scutum samnite du secutor
est compensé par son casque fermé, mais dépourvu
d'aspérités où pourraient s'accrocher le
filet. |
| |
|
Le samnite (samnes)
et les armaturæ dérivées : le
secutor et le provocator |
|
| |
8.4.6. Contra
retiarius
A noter qu'on connaît un autre type d'adversaire du rétiaire
: le contre-rétiaire (contra retiarius),
qui manie une arme longue (lance avec un fer en croissant de lune
pour trancher les rets), porte un casque et une chemise de mailles
qui descend jusqu'à mi-cuisse, mais n'a pas de bouclier
(6).
C'est la lance contre le trident, la chemise de mailles contre
le filet de pêcheur... on voit l'intérêt de
la combinaison.
Le contra retiarius est, avec le crupellarius,
l'andabata et le scissor, un rare exemple de gladiateur
portant cuirasse de mailles ou d'écailles. Ces gladiateurs
cuirassés (7)
ne comptent pas parmi les plus abondamment attestés dans
l'iconographie !
8.4.7. Rétiaires
Armé du trident, du filet et du poignard, le rétiaire
est certainement le gladiateur le plus connu et le plus facilement
identifiable. Cette armatura, qui apparaît dans le
courant du Ier s. av. n.E., est en tout point exceptionnelle car
elle ne relève ni des parmulati ni des scutati.
Tout armement défensif a été sacrifié
au profit de sa légèreté, de sa mobilité,
de sa rapidité. Il combat tête nue - sa protection
de bras gauche, le galerus, étant prolongée
au niveau de l'épaule par un large plateau qui lui protège
le visage -, sans bouclier ni ocrea, et utilise des armes,
filet et trident, qui ne sont jamais utilisées ailleurs
que dans l'arène, alors que l'on voit que les autres armaturæ
sont d'inspiration militaire. Contrairement au thrace, au samnite
ou au gaulois, gladiateurs contemporains de son apparition, le
rétiaire n'est pas un gladiateur «ethnique».
Selon certains auteurs, le rétiaire aurait été
l'arme la moins appréciée, d'où que c'était
souvent lui qui devait faire le bourreau à l'heure méridienne,
en égorgeant certains condamnés à mort. Mais
comme il est parfois représenté portant une tunique,
on a également supposé que cette arme était
appréciée des auctoritas (gladiateurs libres),
ce qui ne laisse pas de nous étonner attendu que ses armes
n'étaient pas celles d'un citoyen honnête.
|
| |
|
| |
8.4.8. D'autres
encore...
Vous suivez toujours ?
En fait, la catégorisation des armaturæ est
très complexe. Les représentations figurées
(lampes à huile, stèles, graffitis, etc.) en offrent
une infinie variété qui peut s'expliquer tant par
l'évolution de l'arme dans le temps ou fonction des moyens
du bord, que par la fantaisie : certains gladiateurs excellant
dans diverses spécialités pouvaient sans doute être
tentés de modifier leur armement en fonction de leurs préférences.
Les faire coïncider avec les textes ou l'iconographie n'est
pas une sinécure.
Il n'empêche que
les équipements étaient relativement standardisés
et que dans Gladiator, l'impressionnante panoplie de Tigris
(casque [8]
et protèges épaules en têtes ou pattes de
tigres) était assez improbable. Autant imaginer le gladiateur
«Fulgor» en costume du superhéros Flash Gordon
(comme aime à le rappeler Brice Lopez) !
Du dimachère, on peut seulement
conjecturer qu'il avait deux coutelas (machæra).
Du scissor on
sait que, démuni de bouclier, il avait une épée
dans la main droite, la gauche se terminant par un manchon garni
d'une lame en demi-lune, pour trancher le filet du rétiaire
(Remarque d'Eric Teyssier : «Quant au scissor il
repose sur une seule et unique mention épigraphique sans
aucune représentation assurée. Je reviens sur ce
problème dans mon livre et je pense qu'il faut plutôt
identifier le gladiateur au manchon à demi-lune à
l'arbelas... une spécialité de la gladiature
orientale... rien à voir avec la Gaule.») |
| |
|
Un gladiateur cuirassé
assez spectaculaire : le scissor, tel que représenté
sur la stèle de Myron,
et sa reconstitution à Bliesbrück, en 2005,
par ACTA-Expérimentation |
|
| |
L'andabata
était entièrement cuirassé et combattait
en aveugle, relié à un autre andabata par une corde.
Assez curieusement, Ridley Scott et les costumiers de Gladiator
confondront l'andabata
avec une sorte de «super»-mirmillon.
(Remarque d'Eric Teyssier : «L'andabata est
une distraction comique qui n'a pratiquement pas laissé
de trace, rien en tout cas après le milieu du Ier ap. J.-C.»)
Le crupellarius
est un gladiateur qui ressemble furieusement à l'andabata
: le rebelle éduen Sacrovir voulut faire d'eux la troupe
de choc de son armée. Mais leur technique spécifique,
adaptée au duel dans l'arène, n'offrait que des
désavantages sur le champ de bataille. Il suffisait de
les culbuter pour les rendre impuissants !
Certain auteurs ont cependant voulu les rapprocher, puisque Gaulois,
des mirmillons lesquels, bien au contraire, étaient très
légèrement armés - pas de protection de bras
ni de jambes, encore moins du torse.
(Remarque d'Eric Teyssier : «Quant au crupelarius,
il n'est connu que par une seule et unique mention dans Tacite
(sous Tibère) et la seule représentation connue
(une statuette de la Fère) n'est pas assurée quant
à son attribution.») |
| |
8.5.
Les armaturæ à l'écran
La plupart des films méconnaissent les armaturæ,
qu'il s'agisse de superproductions soignées comme le Spartacus
de Kubrick ou de séries Z comme le remake de La
révolte des gladiatrices (1973), The Arena (2001)
tourné en Russie. Dans ce dernier film, qui semble se passer
au IIe s. de n.E., l'on voit combattre des barbares en casques
à cornes, des femmes en justaucorps garni de plaques de
métal et cotte de maille, avec bouclier, glaive surdimensionné
de légionnaire et sans casque, et surtout - la cerise sur
le gâteau - un rétiaire lourdement cuirassé,
et affublé d'un casque médiéval prolongé
par des mailles - la négation même de sa spécificité.
Dans Gladiator on voit une spectaculaire épée
à deux lames divergentes et au maniement improbable. Dans
Gladiator encore, comme dans le récent Pompéi
(Paolo Poeti), des gladiateurs manient double hache, massue ou
fléau d'armes : toutes espèces d'armes aucunement
attestée dans nos sources antiques !
|
|
| 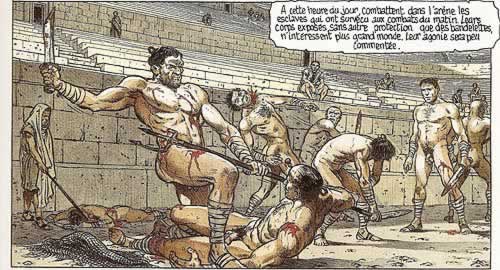
Gladiateurs combattant «nus»,
toute l'ambiguïté d'un terme signifiant aussi
bien «intégralement nu» que «peu
vêtu» ! (Philippe Delaby (d.) et Jean Dufaux
(sc.), Murena
- La pourpre et l'or, 1997) |
|
| |
Dans son roman, Howard
Fast parlait de gladiateurs nus, qui se battaient armés
d'un simple coutelas : conservant l'idée, le film de Kubrick
leur concédait un petit bouclier... à peine plus
large que le poing, un glaive de légionnaire (mais de n'est
pas une faute, en -70), une manica correctement positionnée
sur le bras droit, mais pas de casque. En revanche, le rétiaire
Draba est, lui, correctement équipé (trident, filet,
manica sur le bras gauche), quoiqu'il lui manque le galerus
et le poignard. Il est vrai que le film se justifie d'un combat
privé et du caprice d'une riche visiteuse qui souhaite
voir les hommes se battre nus. Quarante ans plus tard, se souvenant
du roman, Delaby et Dufaux démarreront leur BD Murena
par un combat au finish d'une bande de gladiateurs entièrement
nus, osant ce que le cinéaste n'avait fait qu'esquisser
(9).
Les deux documents qui suivent illustrent les erreurs les plus
banales. |
|
 |
| |
Dessin publicitaire pour
Les esclaves les plus forts du monde
(Soit deux gladiateurs au premier plan, de gauche
à droite : A et B;
deux gladiateurs au deuxième plan, de gauche
à droite : C et D;
trois gladiateurs au troisième plan, de gauche
à droite : E, F et G.) |
| 1. |
Tous sans exception portent
la manica sur le bras gauche qui tient un petit
bouclier rond ou rectangulaire (parma), ce qui
est une erreur sauf dans le cas de C, qui est
un rétiaire. Seul le rétiaire porte la
manica sur le bras gauche, qui tient le filet,
mais il lui manque ici le galerus. |
| 2. |
A, B et C
arborent le cardiophylax (plaque sur la poitrine),
accessoire peu fréquent. Seuls les provocatores
portent parfois une protection de poitrine, mais les
provocatores sont des scutarii (boucliers
longs) et l'on n'en voit aucun ici (10). |
| 3. |
A porte une unique
ocrea haute de thrace, mais sur la mauvaise jambe
: il ferait mieux de la permuter avec sa manica
(qui doit aller au bras droit). L'ocrea unique
est toujours sur la jambe gauche, celle qui s'avance
sous le court bouclier. L'erreur de l'accessoiriste
provient du fait que le maître d'armes du film
ne semble pas avoir compris le principe de l'escrime
avec bouclier : c'est le bouclier, donc le côté
gauche du corps, qui se porte en avant. Exactement le
contraire de l'escrime contemporaine. |
| 4. |
Enfin G, est un parmularii
(thrace ?) qui brandit un trident : ce n'est pas son
arme, mais peut-être l'a-t-il prise à un
rétiaire vaincu. |
|
| 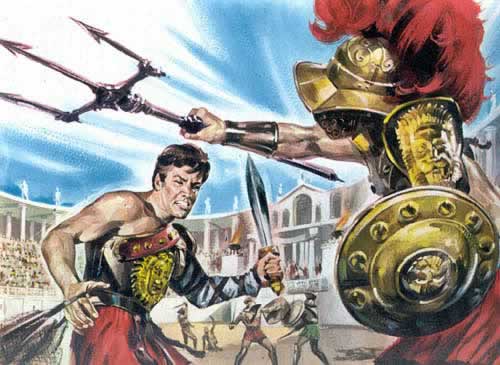
Dessin publicitaire pour La fureur des
gladiateurs
Le combattant de gauche est assez cocasse : c'est un rétiaire,
puisqu'il tient un filet de sa main droite, tandis que sa
gauche (manica correctement positionnée, mais
pas de galerus !) brandit un glaive surdimensionné.
Sa cuirasse est, par contre, une véritable hérésie
plus particulièrement sur un rétiaire, qui
est un combattant léger.
Son opposant, à droite, non seulement porte une manica
au même bras que sa parma, mais en plus un
galerus, qui non seulement ne lui sert à rien
parce que trop petit, mais en outre - s'il était
de dimensions correctes - ferait double emploi avec son
casque. |
|
| |
8.6.
Qui sont les gladiateurs ?
Il faut distinguer d'abord les condamnés à mort
(noxii ad gladium damnati) des gladiateurs proprement dits.
Les guerres de l'Antiquité appellent, souvent, le massacre
systématique des vaincus. Ainsi, sur le champ de bataille,
les Assyriens aimaient à empiler en pyramides les têtes
de leurs ennemis, à tapisser les murs des villes rebelles
de la peau de leurs chefs écorchés vifs. Les Athéniens
réduisirent en esclavage les femmes et les enfants de Mitylène,
leur alliée rebelle, massacrèrent les mâles
aptes à porter les armes et émasculèrent
les jeunes garçons. Et les Syracusains laissèrent
mourir de faim dans les Latomies les Athéniens du corps
expéditionnaire fait prisonniers.
Lors du triomphe de leurs généraux, les Romains
- quant à eux - exhibaient les chefs ennemis, avant de
les étrangler (ou, plus rarement, de les gracier) et faisaient
périr dans l'arène leurs meilleurs guerriers, obligés
de s'entre-tuer. Les «armes ethniques» de la gladiature
(Samnites, Gaulois, Thraces) tirent de là leur origine,
à côté des «armes techniques»
(mirmillons, rétiaires, hoplomaques, venatores...).
Toutefois, ces prisonniers de guerre massivement condamnés
à mort n'étaient pas de vrais gladiateurs : un gladiateur
est un combattant - esclave désigné ou volontaire
libre, peu importe - spécialement entraîné
pour exécuter des performances dont l'issue peut être,
parfois, mortelle. Mais comme ils sont adroits et coûtent
très cher, la mise à mort du vaincu n'est pas une
fin en soi, même si la foule des spectateurs réputés
avides de sang attend fébrilement cet instant privilégié
où la carotide tranchée, celui-ci expulsera son
sang à gros bouillons.
On a retrouvé à Pompéi,
annoté par un tifosi, un programme de munera
(11),
| |
THRACE-MYRMILLON |
|
| Victoire |
Pugnax, de l'école néronienne |
3 victoires |
| Mort |
Murranus, de l'école
néronienne |
3 victoires |
| |
HOPLOMAQUE-THRACE |
|
| Victoire |
Cycnus, de l'école julienne |
8 victoires |
| Epargné |
Atticus, de l'école
julienne |
14 victoires |
| |
ESSÉDAIRES |
|
| Epargné |
Publius Ostorius |
51 victoires |
| Victoire |
Scylax, de l'école julienne |
26 victoires |
qui nous apprend que sur trois duels, deux virent le vaincu épargné,
un seul eut une issue fatale, et encore opposait-il des débutants
n'ayant qu'un modeste palmarès de trois victoires chacun.
8.6.1. Ne pas confondre...
On n'a pas eu le temps de former aux règles du ludus,
d'incorporer dans une armatura ces condamnés raflés,
prisonniers de guerre opposés en combats gregatim
- les Daces et les Suèves d'Octavien, les Bretons de Claude,
les Juifs de Titus. C'étaient des vaincus destinés
à mourir, qui se battirent avec leurs armes nationales.
Mais ce n'étaient pas de vrais gladiateurs, formés
en vue de performances spécifiques. Du reste, on distinguera
les damnati ad ludum, qui sont des combattants ennemis,
des damnati ad bestias qui sont plutôt des sujets
rebelles. Ainsi les transfuges romains repris par Paul Emile après
la bataille de Cynoscéphale furent voués à
être piétinés par les éléphants.
Il est clair également que, lorsque par une naumachie Claude
inaugura les travaux d'assèchement du lac Fucin, on n'attendait
pas des 19.000 condamnés à mort qu'ils fassent démonstration
d'une escrime savante et codifiée, sous le contrôle
d'un arbitre. C'est sous la menace des balistes des prétoriens
qu'ils se constituèrent en flottes des «Rhodiens»
et des «Siciliens», fortes de douze trirèmes
chacune, et se prirent à l'abordage. Bien que ce spectacle
soit décrit à la suite d'une série d'anecdotes
relatives à l'attitude de Claude vis-à-vis des gladiateurs
(SUÉT., Claude, XXI), il est évident que
ceux-ci n'en étaient pas dans le sens technique du terme.
Il ne s'agissait que de liquider un lot de captifs considérés
comme dangereux, rien de plus. Le plus drôle c'est que ce
furent eux qui saluèrent Claude de la fameuse phrase «Have
imperator, morituri te salutant», dont on
a fait - à tort - la salutation rituelle des gladiateurs.
8.6.2. Sportifs de haut niveau
Bien sûr, de ces lots on peut toujours extraire quelques
intéressants sujets sociopathes, aptes à se soumettre
à la rude discipline du ludus, qui recevront ultérieurement
le même entraînement que les hommes libres «volontaires
sous contrat» (les auctoritas...). Ceux-là
seront, alors, de vrais gladiateurs. Dans l'arène, ils
combattront avec un armement spécifique, en général
des coutelas plutôt que des glaives ou spatha, selon des
règles (lex pugnandi) soumises au jugement d'un
arbitre. Quintilien nous a conservé l'écho des discussions
passionnées des afficionados, qui rappelle notre
escrime moderne : «Le coup du gladiateur appelé
«seconde» [= riposte] devient «tierce»
[= riposte à la riposte] si le premier coup n'était
pas destiné qu'à provoquer l'attaque adverse et
même «quarte» si la feinte a été
répétée deux fois» (QUINTILIEN,
Institution oratoire, V, XIII, 54).
Entourés par des entraîneurs, masseurs, diététiciens,
ces «sportifs de haut niveau» chercheront à
épuiser leur adversaire en lui infligeant des blessures
superficielles, jusqu'à obtenir sa soumission, comme le
rappelle Georges Ville : «Il s'agissait, non de dominer
techniquement un adversaire, mais d'acculer un homme à
demander lui-même qu'on décidât délibérément
de sa vie ou de sa mise à mort.»
C'est alors, et alors seulement, que le peuple donnant ses
suffrages tentera d'influencer l'éditeur des jeux qui seul
a pouvoir de décision. Celui-ci songe avec mélancolie
à la perte financière que représente la mise
à mort de ce combattant malchanceux; en même temps,
il songe à sa popularité et se trouve tenté
de se rallier à l'avis général. «Ure
!» («Brûle le !»), crie-t-on aux lorarii
pour qu'ils stimulent au fer rouge un combattant trop timide.
«Habet» ou «Hoc habet» («Il
en a»), souligne-t-on lorsque l'un d'eux a pris un mauvais
coup. Mais lorsque le vaincu, ayant jeté son bouclier,
tend l'index de la main gauche (12,
c'est l'hallali : «Jugula !» («Egorge-le
!»), s'il a été en dessous de tout, ou «Mitte
!» («Qu'il s'en aille !»), s'il a courageusement
combattu.
8.6.3. Des athlètes gras ?
Les gladiateurs étaient des athlètes surentraînés,
surveillés par des diététiciens. L'image
romantique prolongée par le cinéma nous a campé
des gladiateurs à la musculature noueuse et grand mangeurs
de viande.
Il n'y a sans doute pas grand-chose à retenir de la thèse
soutenue par ces anthropologues autrichiens - Karl Grossschmidt,
médecin-légiste, de l'Institut autrichien d'archéologie
et Fabian Kanz, de l'Institut de chimie analytique de l'Université
de Vienne) - qui étudièrent les squelettes de 70
gladiateurs exhumés à Ephèse, et selon qui
«les analyses effectuées tendent à prouver
qu'ils se nourrissaient principalement d'orge, de haricots et
de fruits secs». Selon eux, la méthode dite de
«micro-analyse des éléments» permet
de déterminer, grâce à une sonde nucléaire,
les concentrations en éléments chimiques contenus
par les ossements, et ainsi déduire quelles proportions
de poisson, viande, céréales et fruits composaient
le régime alimentaire du défunt. Un régime
composé de viande et de légumes laisse des traces
équilibrées de zinc et de strontium, alors qu'un
régime végétarien est dénoncé
par une haute teneur en strontium et une faible teneur en zinc.
Selon ces spécialistes, les gladiateurs romain étaient
donc gras, peut-être délibérément,
pour compenser l'absence d'armure en protégeant par un
matelassage graisseux leurs organes vitaux contre des lames effilées
comme des rasoirs. Resterait à prouver l'efficacité
de ce genre de protection; est-on seulement certain qu'il s'agissait
bien des restes de gladiateurs ?
8.6.4. Récompenses
Le gladiateur vainqueur exécute la sentence éventuelle,
puis reçoit une palme (parfois une couronne de lauriers).
«Le gladiateur victorieux, écrit J. Carcopino,
était récompensé séance tenante.
Il recevait des plats d'argent chargés de pièces
d'or [præmium] et de cadeaux précieux et,
ses présents dans la main, il traversait l'arène
en courant, sous les acclamations de la cavea.» Parfois
un glaive de bois (rudis) était offert au vainqueur
(rudarii) ce qui signifiait qu'il était définitivement
libéré de son obligation de combattre. Il pouvait
alors se choisir une nouvelle vie, ou rester dans le monde de
l'arène comme instructeur (doctor). Nombre de rudarii...
choisissaient de rempiler, comme ce Flamma aux 21 victoires qui,
quatre fois libéré, se réengagea quatre fois.
8.6.5. Les collèges funéraires
Une note amusante pour conclure. Nous avons vu que la formule
«Ave Cæsar, morituri te salutant» ne
fut prononcée qu'une seule fois, à l'occasion d'une
naumachie sur le lac Fucin, opposant plusieurs milliers de prisonniers
de guerre. La réponse évasive de l'empereur Claude
suggéra aux condamnés qu'ils étaient graciés
- aussi refusèrent-ils de combattre. Ce qui nous renvoie
au parodique Deux heures moins de quart av. J.-C., quand
le mirmillon Michel Constantin - porte-parole de ses camarades
- refuse de se battre «pour des raisons syndicales»...
Au delà de l'anachronisme délibéré
voulu par Jean Yanne, il faut considérer qu'en fait, les
premiers «syndicats» - en l'occurrence des collèges
funéraires -, furent bel et bien inventés par les
damnés de l'arène.
En effet, tandis que des valets retournaient au râteau le
sable ensanglanté, des comparses armés d'un maillet
et déguisés en Hermès Psychopompe (13)
ou en Charon (14), frappent
les morts sur le front pour s'assurer de leur décès.
La profession ne jouissant d'aucune considération sociale,
les gladiateurs s'étaient en conséquence organisés
en collèges funéraires afin de s'assurer, par leurs
cotisations, une sépulture décente ! Leurs cadavres
sont alors évacués en civière par les libitinarii.
Et ce sont les carcasses des simples condamnés à
morts qui sont traînés vers les égouts au
moyen de crochets de fer.
|
| |
|
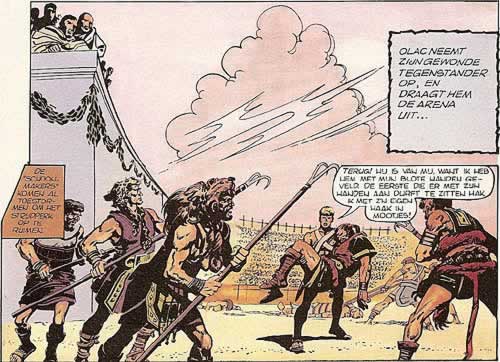
Armés de leurs crocs de fer, les libitinarii
s'apprêtent à déblayer l'arène
des cadavres qui l'encombrent
(Don Lawrence, Olac the Gladiator)
|
|
| |
Le succès du Gladiator
de Ridley Scott a incité la BBC à consacrer aux
gladiateurs un docufiction essayant de retracer avec quelqu'objectivité
ce que fut exactement la vie des professionnels de l'amphithéâtre
(Les Gladiateurs,
Tilman Remme).
|
| |
|
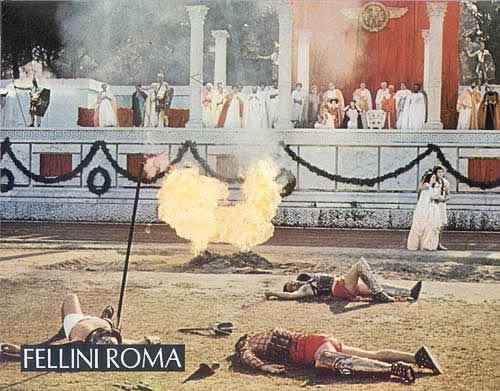
Dans Roma, Federico
Fellini rend hommage aux péplums de son enfance.
Attention : cette photo d'exploitation est en couleur, mais
dans le film les séquences reconstituées par
le Maître sont en noir et blanc
|
|
| Suite… |
|
NOTES :
(1) Lors d'une de ses exhibitions,
Brice Lopez (ACTA-Expérimentation)
nous a fait une démonstration très convaincante
quant à l'escrime du thrace. - Retour
texte
(2) J. DUBOIS, Ludi et Circenses.
I. Les combats de gladiateurs, Bruxelles, Le Cimier, 1978.
- Retour texte
(3) Cf. GOLVIN & LANDES,
op. cit., p. 161. - Retour texte
(4) Le thrace a un casque à
larges bords (comme les mirmillons et les samnites), ouvert
ou fermé, souvent surmonté d'une ou deux plume(s)
ou d'un griffon. On connaît par une statuette en ivoire
(poignée de couteau pliant trouvé à Italica
(Seville, Espagne), à l'effigie d'un certain Senilus)
un porteur d'un casque plus particulier, en forme de griffon
dont les ailes déployées remplacent les larges
bords. Casque de parade, peut-être ? Il porte de hautes
jambières, et ses cuisses sont entourées de fasciæ
(lanières de cuir).
Le thrace a un petit bouclier carré (parma), mais
les jambières (ocreæ) sont facultatives.
- Retour texte
(5) C'est Jacques Dubois (Lvdi
et circenses. I. Les combats de gladiateurs, Bruxelles,
Le Cimier, 1978) qui dote le provocator d'une épée
longue (laquelle en fait est plutôt l'arme du gallus).
Eric Teyssier et Brice Lopez (op.
cit.) ont toutefois prouvé qu'au Ier s. de n.E.
les glaives surdimensionnés ont, dans l'arène,
disparus au profit des dagues. - Retour
texte
(6) Cf. GOLVIN & LANDES,
op. cit., p. 166. - Retour texte
(7) Il y a aussi le provocator, avec
son petit cardiophylax. - Retour
texte
(8) Avec un masque facial rétractable,
d'un type inconnu des Romains qui pourtant connaissaient les
casques à masque humain métallique amovibles.
- Retour texte
(9) Et ils publieront un erratum
à ce sujet, dans l'album suivant. - Retour
texte
(10) Les quelques boucliers rectangulaires
que l'on voit sur ce dessin sont tellement petits qu'on hésiterait
à les considérer comme scuti. Il faut toutefois
relativiser : dans les films des années '60, le scutum
des légionnaires est à peine plus grand que ceux
qu'on voit ici. Sous l'influence de l'archéologie expérimentale,
cette tendance est en train de s'inverser et, de l'Astérix
de Claude Zidi à Gladiator, le scutum romain
a enfin des dimensions correctes. (Sauf qu'à l'époque
de Jules César, les légionnaires étaient
tout autrement équipés que dans les «Astérix»
life). - Retour texte
(11) C.I.L., 2508; MAU-KELSEY,
p. 217-219 - cité par R. ETIENNE, La vie quotidienne
à Pompéi, Hachette, 1966, p. 438. - Retour
texte
(12) L'index de la main droite pour
le rétiaire (dont le bras et la main gauche sont entièrement
recouverts par la manica). - Retour
texte
(13) Hermès conduisait aux
Enfers les âmes des défunts. - Retour
texte
(14) Le nocher du Styx. Ou encore
Dis Pater (Pluton). Ces figures masquées apparaissent
au Ier s. de n.E., ou seulement au IIe s. - Retour
texte
|
| |
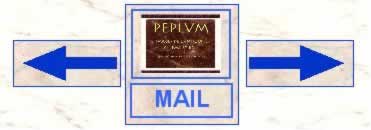 |
|