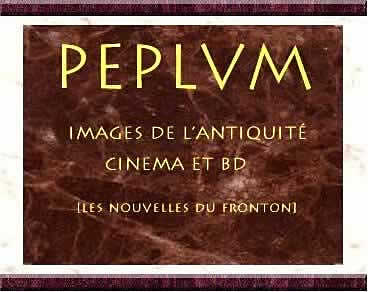 |
| |
| |
L'AIGLE DE ROME
(Eagle
in the Snow, 1970)
Roman de Wallace BREEM
|
|
| |
|
| |
|
| |
23 avril 2014
Wallace BREEM, L'Aigle de Rome (Eagle in
the Snow, 1970), Panini Books éd., coll.
«Éclipse», série «Invicta»,
480 p.
EAN 9782809436563
Au cours de l'hiver 406 de n.È., l'Empire
romain est menacé de tous côtés par ses ennemis.
Maximus Gaius Paulinus, commandant de la Legio XX Valeria Victrix,
est envoyé par le général Stilicon tenir
le limes en Germanie. De l'autre côté du Rhin,
plus de deux cent mille barbares s'unissent, prêts à
fondre sur la Gaule et sur Rome. C'est avec sa seule légion
que Maximus devra former la dernière ligne de défense
de l'Empire. Une tâche impossible si ce n'est grâce
au majestueux rempart naturel que forme le fleuve.
Usant d'une combinaison de stratégie militaire, de
ruse et de diplomatie, Maximus parvient à tenir ses positions
malgré la menace croissante de l'ennemi. Toutefois, les
intrigues politiques menacent ses arrières, et Maximus
doit se battre autant contre les barbares que contre l'administration
corrompue qui lui refuse ses demandes de soutien. Pressé
par les siens de prendre la pourpre, Maximus devra honorer ses
serments de fidélité et risquer tout ce qu'il lui
reste pour son Aigle...
Le dessert des Barbares
Passionnant, mais curieux roman historique que L'Aigle de
Rome, qui au-delà de l'épique replace la chose
militaire bien au centre du débat. L'analogie avec le célèbre
roman de Dino Bruzzati s'arrêtant ici : le héros
de notre histoire n'aspire nullement à une bataille qui
lui vaudra de l'avancement. Plus prosaïquement, il attend
de pied ferme l'indicible marée humaine qui va précipiter
l'Empire romain dans les tréfonds de l'abîme...
Ancien officier dans l'Armée des Indes, Wallace Breem
est très soucieux de décrire les responsabilités
d'un commandant de légion, ses problèmes avec une
hiérarchie veule ou défaitiste. Les moyens d'action
lui sont âprement comptés, et Maximus doit gérer,
superviser l'intendance, l'approvisionnement en armes... en nourriture...
en chevaux. Le recrutement de nouveaux légionnaires ou
auxiliaires. Leur formation. Le moral de la troupe, quitte à
la gaver de pieux mensonges (ces renforts qui vont arriver !).
L'entretien des fortifications, etc. La délicate négociation
avec les autorités civiles et religieuses de Treverorum
(Trèves), qu'il est censé défendre... l'évêque
chrétien Mauritius, le curator Artorius que idéologiquement
tout oppose à lui - militaire et zélateur de Mithra,
dieu des légions. Dans les romans historiques sur l'Antiquité
romaine, le fait est trop rare pour ne pas être signalé.
Car notre héros, Maximus, n'est pas de la même veine
qu'un de ces païens décadents et superficiels du Ier
s. de n.È. tels Vinicius dans Quo Vadis ou Glaucus
dans Les Derniers jours de Pompéi. Maximus est un
dévot de Mithra qui vit sincèrement sa foi et n'accepte
pas que des barbares lui imposent la leur. Ca vous fait songer
à quelque chose ? L'Histoire n'est qu'un éternel
recommencement, n'est-ce pas...
Sous le règne de l'infantile Honorius - et ce depuis son
père, Théodose «le Grand» -, les païens
sont exclus de l'armée et de l'administration romaines.
Aussi notre mithraïste Maximus ne doit-il son commandement
qu'à ses compétences et à l'urgence des circonstances.
Aux grands maux, les grands remèdes ! En fin de volume,
un petit appendice signé Isabelle Gonon met en évidence
les subtiles relations de Maximus avec sa religion - dont il est
un initié du plus haut grade - face à des chrétiens
catholiques, mais prêts à pactiser avec les Vandales
ou les Burgondes ariens, certes donc hérétiques,
mais chrétiens tout de même (1)
! Quand on songe à ce potentiel de haine sectaire qui,
dans l'Antiquité, a opposé Nicéens (catholiques
orthodoxes) aux Ariens et autres Monophysites, Donatistes etc.
puis, au fil de l'Histoire, divisé entre eux Catholiques
et Orthodoxes, avant d'opposer Catholiques et Protestants... À
considérer l'état de délicatesse où
se trouvent encore sunnites et chiites, les Musulmans n'y ont
pas échappé... Le culte du Dieu «d'amour et
de charité» laisse un peu perplexe !
C'est la pression des Huns et la famine qui pousse ces déracinés
à vouloir forcer les portes de l'Empire romain pour s'y
établir - pourquoi pas ? - comme fédérés.
«Rome a besoin de nous», dit le roi vandale
Gondéric. De fait, celui qui a chargé Maximus de
défendre Trèves et Mayence - le généralissime
romain Stilicon - est lui-même d'origine vandale (2).
Avec l'aide de leurs alliés Francs et Alains, Maximus et
la XX Valeria Victrix vont obstinément s'opposer
aux envahisseurs. Le commandant et sa troupe obéiront aux
ordres reçus, à leur serment de légionnaires.
Ils ne reculeront pas et livreront bientôt leur ultime baroud
d'honneur.
Situation complexe d'un Empire en voie de barbarisation, qui
quarante-cinq ans plus tard verra encore le Maître de la
Milice romaine Ætius, un Pannonien, mobiliser Francs et
Wisigoths contre les Huns. Lesquels Huns, faut-il le rappeler,
avaient précédemment servi sous les aigles romaines
du même Ætius... contre lesdits Francs !
I. Remarques historiques
Ceci posé, un roman historique est aussi - et avant tout
- tout simplement un roman. Et l'Histoire un matériau brut
que va pétrir le romancier pour en tirer sa fiction...
historique. On sait assez peu de choses sur cette nuit du 31 décembre
406-1er janvier 407. C'est Prosper d'Aquitaine qui nous en a précisé
la date (3),
mais la tradition d'un franchissement du Rhin «gelé»
semble bien apocryphe (4).
Les Vandales et leurs alliés empruntèrent plus probablement
le pont romain de Bingium (auquel, du reste, le roman fait souvent
allusion).
Il ne semble pas que l'armée romaine se soit, à
Mayence (5),
militairement opposée à cette invasion - en tout
cas probablement pas la XX Valeria Victrix dont on perd
la trace dans le courant du IIIe s. Sauf que sous Gallien (emp.
253-268), quelques éléments de cette même
légion semblent bien avoir été envoyés
à Mayence, ce qui évidemment ne veut pas dire que
150 ans plus tard ils s'y trouvaient encore, au moment des faits
«reconstitués» dans le roman (voir Tableau
chronologique) !
• La Notitia dignitatum
Composée entre 390 et 425, la Notitia dignitatum
dresse la «nomenklatura» militaro-administrative du
Bas-Empire; elle ne mentionne plus la XX Valeria Victrix
mais énumère des légions «à
matricule» (6)
et des auxiliats palatins qui eux n'en ont pas. Ammien Marcellin,
qui participa à la bataille d'Amida (360), cite la présence
de la V Parthica, de la XXX (probablement l'Ulpia
Victrix) et de la X, mais aussi e.a. une légion
dite de «Magnence» c'est-à-dire les Herculiani
seniores (7)
(AMM., XVIII, 9). Mais sa relation de la bataille de Strasbourg
(357), qui eut lieu trois ans plus tôt, montre sous les
ordres du César Julien presque essentiellement des auxiliats
palatins tels les Cornuti, Brachiati, Bataui, mais aussi
une légion d'accompagnement (comitatenses) : les
Regii (AMM.,
XVI, 12).
Dans la légion romaine du Haut-Empire, il y avait dix
cohortes. Gardienne de l'Aigle, la première cohorte était
milliaire (1.000 h), les neuf autres quingénaires (500
h). Une première restructuration sous Dioclétien
(emp. 284-313) a vu exploser le nombre de légions portant
le même matricule (8)
mais avec des dénominations inusuelles, plutôt vernaculaires,
ce qui suggère un fractionnement en autant de détachements
d'une ou deux cohortes quingénaires pour former des corps
de 800/1.200 h : les légions palatines du Bas-Empire. R.
Cagnat (9)
a dressé la liste de ces nouvelles unités dioclétiennes
qui annoncent la Notitia dignitatum. «... sous Dioclétien,
tout avait changé : une nouvelle armée voyait le
jour, avec des régiments auxiliaires constitués
de provinciaux, et même de Barbares, souhaitant servir Rome.
La cavalerie devenait la formation militaire de pointe, et les
légions étaient reléguées à
la surveillance des frontières de l'Empire. Mais ici, en
Bretagne, les trois légions présentes demeuraient
incontournables» (L'Aigle..., p. 15). C'est pourquoi
le roman signale la VI à Eburacum [York] (p. 60)
et la II Augusta à Rutupiæ [Richborough] (p.
60) et à Isca Silurum [Caerleon] (pp. 15 & 37).
En fait, selon la Notitia, le duc des Bretagnes avait
à sa disposition une Leg. VI à côté
de 38 autres cohortes d'infanterie ou unités de cavalerie,
dont 25 rien que sur le mur d'Hadrien (10).
Le comte de Bretagne a, lui, à sa disposition, les auxiliats
Victores iuniores Britanniciani et les deux autres «Britonnes»
: I et II Iuniores (11);
ainsi également que six vexillations de cavalerie (cataphractaires
juniors, scutaires Auréliaques, Honoriani seniores,
écuries impériales, Syriens et Taïfales (12).
D'autres unités enfin relèvent du comte du littoral
saxon (Fortiens, Tongres, cavaliers Dalmates etc.), mais aussi
la II Augusta, à Rutupiæ donc (13),
qui n'avait pas été comptabilisée ailleurs.
En fait nombre d'unités semblent avoir un don d'ubiquité
ou plus probablement ont été scindées - à
moins bien sûr qu'il s'agisse d'une erreur de collationnement
dans le temps.
C'est donc à juste titre que Wallace Breem mentionne encore
la présence en Bretagne des légions II et
VI, ce qui ne solutionne pas pour la XX bien évidemment.
À l'article «Legio» R. Cagnat (14),
concluant son historique de la XX, observe en note de bas
de page le fait que les Victores Britanniciani sont classés
parmi les auxiliats, non les légions (Not. Occ.,
VII), ce qui ne plaide pas en faveur d'une quelconque continuité
de notre XX Valeria Victrix.
• Un nouvel ordre de bataille
Sous le Bas-Empire, l'administration mise en place sous les Julio-Claudiens
et les Antonins a été repensée. À
côté du præfectus prætorio (préfet
du prétoire des Gaules) et du magister equitum per Gallias,
se profile la future aristocratie médiévale des
Ducs et Comtes : ainsi le dux Britanniarum Fullofaudes
et son collègue le dux Belgicæ, ou le commandant
du littoral saxon Nectaridus (comes maritimi tractus).
Pourtant, sur le plan militaire, Wallace Breem s'est plutôt
documenté sur les légions du Haut-Empire (voir tableau
de L'ordre de bataille sous Trajan) (15),
qui pour beaucoup n'existaient plus fin du IVe s. ou avaient été
profondément restructurées. Dans son Empire barbare,
qui se passe des décennies plus tard au temps du roi Ostrogoth
Théodoric (454-525), Gary Jennings ne fera pas mieux, sinon
pire.
• Effectifs et équipements
L'Aigle de Rome évoque constamment les casques et
les cuirasses des légionnaires romains et un effectif de
6.000 hommes. Or depuis les réformes de Gratien (emp. 375-383),
soit une bonne vingtaine d'années auparavant, les Romains
avaient délaissé ces encombrants accessoires : «C'est
ici le lieu d'exposer quelles doivent être les armes offensives
et défensives du conscrit. L'usage ancien à cet
égard a disparu complètement, écrit Végèce.
Si, à l'exemple des Goths, des Alains et des Huns, l'équipement
du cavalier a été perfectionné, l'on sait
que le fantassin est totalement dépourvu de moyens de défense.
À dater de la fondation de Rome jusqu'à l'époque
de l'empereur Gratien [c'est nous qui soulignons], l'infanterie
eut le casque et les cataphractes (16).
Mais depuis qu'une insouciante paresse a fait cesser les manœuvres
du terrain, ces armes ont commencé à paraître
pesantes, et le soldat ne les a revêtues que rarement. On
sollicita auprès de l'Empereur la réforme des cataphractes
d'abord, puis celle des casques. Dès lors, nos soldats,
la poitrine et la tête découvertes, furent écrasés
plus d'une fois, dans les guerres des Goths, par la multitude
de leurs archers; et malgré tant de désastres qui
occasionnèrent la ruine de villes très importantes,
il n'est venu à l'idée de personne de rendre à
l'infanterie ses armes de défense. Il en résulte
que le soldat qui se voit en butte aux coups, sans que rien ne
le garantisse, songe moins à se battre qu'à fuir»
(17)(VÉGÈCE,
I, 20).
Selon la philosophie stratégique du Bas-Empire, les légions
qui autrefois campaient sur les points stratégiques du
limes, laissant aux auxiliaires le contrôle des intervalles,
ont reculé pour pouvoir assurer une défense en profondeur.
Le limes proprement dit est maintenant assumé par
les «gardes-frontières», les limitanei.
Théoriquement, la Gaule est défendue par 136.000
limitanei germaniques et 113.000 comitatenses représentant
les forces légionnaires de l'intérieur. Ces comitatenses
constituaient le troisième échelon dans la hiérarchie
de l'armée romaine du IVe s., qui se décline comme
suit : 1) les scholes palatines (l'élite, aussi école
des officiers); 2) les légionnaires et auxiliaires palatins;
3) les comitatenses (l'armée régulière);
4) les pseudo-comitatenses (comitatenses hiérarchiquement
de second ordre); 5) les limitanei. Il n'est bien entendu
pas interdit de penser qu'une troupe légionnaire palatine
aurait pu s'avancer sur ce point stratégique que Mogontiacum
a toujours été dès avant Auguste; sauf qu'il
ne restait plus aucune légion en Gaule - celles-ci ayant
toutes été rappelées par Stilicon pour affronter
l'Ostrogoth Radagaise dans le nord de l'Italie. |
| |
II.
Le franchissement du Rhin
Pour contrer Radagaise (vaincu à Fiésole, près
de Florence, et exécuté le 22 août 406), Stilicon
a vidé de ses troupes et abandonné la Gaule afin
de concentrer toutes les unités disponibles autour de Ravenne
où se terre un éleveur de poulets, le peu viril
empereur Honorius (18).
Dans la nuit-charnière des années 406-407, quatre
hordes - les Suèves, les Vandales Asdingues, les Vandales
Silingues et les Alains - franchissent le Rhin. On les évalue
entre 100.000 et 200.000 âmes, femmes et enfants compris,
soit 20.000 combattants. Nulle troupe romaine n'est là
pour s'opposer à eux, pas même une hypothétique
légion fantôme. Sauf 3.000 fédérés
Francs rhénans [estimation], bien déterminés
à défendre leur territoire ! Selon Grégoire
de Tours, «Renatus Profuturus Frigeridus (...) dit :
«Pendant ce temps, Goar, ayant passé aux Romains,
Respendial, roi des Alains, retira son armée des bords
du Rhin, car les Vandales étaient en guerre avec les Francs.
Le roi Godégisel avait succombé, et une armée
de près de vingt mille hommes avait péri par le
fer. Les Vandales auraient été détruits si
les Alains ne les eussent secourus à temps.»
Nous sommes étonnés que, nommant par leur nom les
rois des autres nations, l'historien ne dise pas aussi celui du
roi des Francs» (GRÉG., Hist. Francs,
II). Il appert donc que les Francs - dont Grégoire s'étonne
qu'on ait perdu le souvenir du nom de leur roi, mais à
qui W. Breem attribue celui de *Marcomir - s'opposèrent
à la colonne des Vandales Asdingues, dont ils tuèrent
le roi Godégisel [Godogeisal], fils de Wisimar. On devine
que l'engagement fut chaud, puisque les Vandales perdirent leur
roi et ne durent de s'en tirer que grâce au secours de l'Alain
Respendial. Au juste, un autre Alain, Goar, ayant pris le parti
des «Romains», plus tard s'établira en Aquitaine
avec son peuple fédéré en accord avec l'«usurpateur»
Jovin († 412). On sait que le fils de Godégisel, Gondéric
conduira son peuple ravager la Gaule, avant de fonder un royaume
en Espagne avec les Alains de Respendial.
Le Rhin franchi, les Barbares pénétrèrent
tranquillement dans Mayence et, quoique eux-mêmes chrétiens
mais hérétiques - ou peut-être justement à
cause de cela (19)
- égorgèrent tranquillement des centaines, sinon
des milliers de paroissiens réfugiés dans l'église.
Saint Jérôme, qui n'y était pas mais semble
bien renseigné, a évoqué ce massacre avec
des envolées lyriques.
• Le sac de Mayence (Mogontiacum)
(janvier 407)
«Des nations innombrables et d'une férocité
inouïe ont occupé toute la Gaule, note en 410
saint Jérôme. Tout le pays qui s'étend
entre les Alpes et les Pyrénées et qui est limité
par l'Océan et le Rhin a été ravagé
par les Quades, les Vandales, les Sarmates, les Alains, les Gépides,
les Hérules, les Saxons, les Burgondes et même, ce
qui est lamentable pour l'État, par les Pannoniens devenus
ses ennemis... C'est vraiment Assur qui est venu avec eux.
Mogontiacum [Mayence], cité jadis illustre, a été
prise et saccagée, et des milliers d'hommes égorgés
dans l'église. Vangiones [Worms] est tombée
après un long siège, Reims, ville puissante, Arras,
la cité des Morins [Térouane ou Boulogne ?] qui
est à l'extrémité du monde, Tournai,
Nemetes [Spire], Argentoratum [Strasbourg], ont été
transférées en Germanie. Les provinces de l'Aquitaine,
de la Novempopulanie [Gascogne], de la Lyonnaise, de la
Narbonnaise ont été dévastées. Les
villes encore épargnées sont dépeuplées
au-dehors par l'épée, au-dedans par la famine.»
Quatre ans plus tard et de Palestine, saint Jérôme,
n'a en manière de consolation rien de mieux à proposer
à Geruchia - cette dame d'Agerunium qu'il engage à
rester dans l'état de viduité [JÉR., lettre
CXXIII Cf. SALVIEN, Du gouvern. Dieu, VII, 12] -
bref, que de s'abstenir de procréer. La Gaule, l'Occident
sont désormais perdus pour la Civilisation. S'appuyant
sur des références bibliques comme l'allusion à
Assur, ou classique - les Morins étant bien entendu «extremi
hominum» comme dans Virgile (Én., VIII,
727) - le ton rhétorique est patent [«au-dehors par
l'épée, au-dedans par la famine» (foris
gladius, intus fames)].
Ce ne sera que dans le courant 407 que l'usurpateur Constantin
III (emp. 407-411) franchira le channel avec les dernières
légions de Bretagne (20).
Depuis quelques années seulement, les chercheurs se sont
intéressés à l'armée romaine du Bas-Empire.
Envoyer la XX Valeria Victrix mourir à Mayence,
sur les bords du Rhin, est une hypothèse intéressante,
mais plus vraisemblablement un impératif romanesque. C'est
dans cette faille temporelle que Wallace Breem a inséré
sa fiction héroïque, au prix d'une légère
distorsion chronologique.
Ce roman parut, donc, en 1970. Deux ans plus tard, Chris Haines
fondera l'Ermine Street Guard - Legio XX Valeria Victrix,
initiant la reconstitution historique et l'archéologie
expérimentale. |
| |
III.
Appendices
1. Chronologie de la Leg. XX Valeria Victrix
Sous Auguste (emp. -30 à
+14)
• De -25 à -13 : combat les Cantabres
en Hispanie [Espagne].
• Campagne en Pannonie [Hongrie]
: commence par un sanglant échec qui - la légion,
une fois reprise en main par Tibère - s'achèvera
par une sanglante victoire sur les Marcomans.
• +6
: sous les ordres de M. Valerius Messala Messalinus, s'illustre
en Illyrie contre Bato. Reçoit le surnom de «Valeria»
qui serait, soit la traduction latine du sabin Nero, cognomen
de Tibère son (re)fondateur, soit une référence
à la région d'Illyrie où elle s'illustra.
• Fin +9 : suite au désastre de Varus (21)
et à la destruction des légions XVII, XIIX et
XIX, est envoyée en renfort à Ara Ubiorum
(Cologne), en Germanie Inférieure. |
Sous Tibère (emp. 14-37)
Décès d'Octave-Auguste (19 août +14)
- Tibère empereur (17 septembre +14)
• +14 : mutinerie des légions qui désirent
voir leurs conditions de service alignées sur celles
des prétoriens (22).
En Pannonie, les VIII Augusta, IX Hispana et XV
Apollinaris du légat Junius Blæsus négocient
avec Drusus II (fils de Tibère) et sa garde de prétoriens.
En Germanie Inférieure, ce sont à Ara Ubiorum
les I Germanica et XX Valeria Victrix
et, à Castra Vetera, les V Alaudæ
et XXI Rapax du légat A. Cæcina qui expriment
leurs doléances à Germanicus qu'ils veulent
contraindre à prendre leur tête.
Sous le commandement de César Germanicus, elle participe
ensuite aux représailles contre Arminius. Elle était
probablement à la bataille d'Idistaviso dont le déroulement
semble avoir inspiré celle qui ouvre le film Gladiator.
• Ensuite cantonnée à Novæsium
(Neuss). |
Sous Caligula (emp. 37-41)
• +39 : Caligula projette de décimer les légions
- dont la XX ? - qui s'étaient mutinées
contre son père Germanicus; celles-là mêmes
qui l'avaient proclamé «Petites Bottes»
(Caligulæ). Mais les légionnaires ne se
laisseront pas faire... (SUÉ., Cal., XLVIII). |
Sous Claude (emp. 41-54)
• +43 : avec les II Augusta, IX Hispana et XIV
Gemina, participe à l'invasion de la Bretagne sous
le commandement d'A. Plautius (23).
Participe à la bataille de Caer Caradoc qui voit la
défaite du roi breton Caractacus.
Cantonnée à Camulodunum (Colchester),
avec des vexillations à Glevum (Gloucester/Kingsholm)
et Viroconium (Wroxeter). |
Sous Néron (emp. 54-68)
• +60 : sous les ordres de Suetonius Paulinus, combat
contre Boudicca, reine des Icéniens.
La légion est ensuite cantonnée à Deva
Victrix (Chester).
• +69 : après la mort
de Néron, prend le parti de Vitellius. Elle envoie
un détachement qui est vaincu à Crémone.
Les survivants rentrent en Bretagne. |
Sous les Flaviens (de 69 à
96)
• Elle partage son cantonnement de Chester
avec la II Adiutrix envoyée en renfort.
• De +78 à +84 : combat dans les Lowlands
sous les ordres de C. Julius Agricola. Construit le camp de
Pinnata Castra (Inchtuthill).
• +88 : retour à Deva. |
Sous les Antonins (de 96
à 192)
ORDRE DE BATAILLE DES LÉGIONS SOUS TRAJAN (ca
144 de n.È)
En Bretagne insulaire : II Augusta (Isca
Silurum [Caerleon], pays de Galles), VI Victrix (Eburacum
[York]), XX Valeria Victrix (Deva [Chester]).
La IX Hispana, qui avec les trois précédentes
avait participé à la conquête de la
Bretagne, a été rappelée sur le Continent
(selon la légende, elle aurait disparu exterminée
au nord du mur d'Hadrien).
Le long du Rhin (du nord au sud) : XXX Ulpia
(Vetera [Birtem, près de Xanten], Germanie Inférieure),
I Minervia (Bonna [Bonn], Germanie Inférieure),
XXII Primigenia (Mogontiacum [Mayence], Germanie
Supérieure), VIII Augusta (Argentoratum [Strasbourg],
Germanie Supérieure).
Sur le Danube (d'ouest en est) : X Gemina
(Vindobona [Vienne], frontière Norique et Pannonie),
XIV Gemina (Carnuntum [Altenburg]), I Adiutrix
(Brigetio [Oszöny], Pannonie Supérieure), II
Adiutrix (Aquincum [Budapest], Pannonie Inférieure),
IV Flavia (Singidunum [Belgrade], frontière
Mésie Supérieure et Pannonie Inférieure),
VII Claudia (Viminiacium [Kostolac], Mésie
Supérieure), XIII Gemina (Apulum [Alba Julia/Karlsburg],
Dacie), I Italica (Novæ [Swisjtow], Mésie
Inférieure), XI Claudia (Durostorum [Silistra],
Mésie Inférieure) et V Macedonica (Troesmis
[?], Mésie Inférieure, delta du Danube).
En Afrique du Nord : III Augusta (Lambæsis
[Lambèse], Algérie).
En Orient (du nord au sud) : XV Apollinaris
(Satala [Sadagh], ouest Arménie), XII Fulminata
(Melitene sur l'Euphrate [Malatya], Cappadoce), XVI Flavia
(Sura sur l'Euphrate [Souriya], nord Syrie), IV Scythica
et III Gallica (Raphana, frontière Arabie
et Palestine syrienne), III Cyrenaica (Bostra [Bosra],
Arabie Pétrée), VI Ferrata Victrix
et X Fretensis (Ælia Capitolina [Jérusalem],
Judée), II Traiana (Nicopolis [ouest Alexandrie],
Égypte).
• La XX participe à la construction
des murs d'Hadrien (constr. 120-138) [A. Platorius Nepos]
puis d'Antonin (constr. ca 140) [Q. Lollius Urbicus]. |
Sous Gallien (emp. 253-268)
• Des détachements sont envoyés à
Mogontiacum (Mayence). Le matricule de la XX
figure sur des monnaies de cet empereur. |
Sous Victorin (usurp. 269-271)
• Comme nombre d'autres légions, son matricule
figure sur des aurei de Victorin [mais pas sur les
monnaies de Carausius (usurp. 286-293), constate le DAREMBERG
& SAGLIO, s.v. «Legio», p. 1088]. |
Sous Dioclétien (emp.
284-313)
• L'armée romaine est réformée :
tout en gardant leur numéro de matricule originel (?),
le nombre des légions explose - fonction probablement
des nombreuses vexillations éparpillées. |
Sous Gratien (emp. 375-383)
• Réforme de l'infanterie résultant de
la «barbarisation» de l'armée : les fantassins
abandonnent d'abord la cuirasse, puis le casque jugés
trop lourds (les armes défensives étant conservées
par la cavalerie, devenue principale force offensive) (VÉGÈCE,
I, 20). |
Sous Honorius (emp. 393-418)
• Hiver 406-407 : franchissement du Rhin à Mogontiacum
par les Vandales, Suèves, Alains etc. en l'absence
de forces armées romaines.
• Printemps 407
: pour reprendre la Gaule aux Barbares, l'usurpateur Constantin
III (usurp. 407-411) et son fils Constant franchissent la
Manche avec les dernières troupes de Bretagne. Dont
le reliquat de la XX ? |
La Notitia dignitatum
(composée entre 390 et 425 ?)
• Énumérant 189 légions pour tout
l'Empire (24),
la Notitia comptabilise pour l'Occident 12 légions
palatines, 65 auxiliats palatins aux noms aussi pittoresques
que Cornuti, Brachiati, Bataui, Celtæ, Petulantes
ou Jovii (25),
32 légions d'accompagnement (comitatenses)
et 18 fausses légions d'accompagnement (pseudocomitatenses),
sans oublier une quarantaine de vexillations de cavalerie
scholaire, palatine ou d'accompagnement Ph. RICHARDOT, op.
cit., pp. 83-89..
Quoique mentionnant nombre de légions «à
matricules» (dont les II et VI pour
la Bretagne), elle ne reprend plus la XX Valeria Victrix. |
1970
• Wallace
Breem publie L'Aigle de Rome (Eagle in the Snow). |
1972
•
Le reconstituteur Chris Haines fonde l'Ermine Street Guard
(XX Valeria Victrix). |
Liens Internet
À propos de la XX Valeria Victrix (click)
La XX Valeria Victrix et les troupes de reconstitution
(re-enactment) :
... en Grande-Bretagne (click)
... aux États-Unis (Maryland - fondée en 1991)
(click)
... en Italie (click) |
| |
|
2. Ioviani &
Herculiani, Protectores Domestici et Scholes Palatines.
(Des Prétoriens aux Excubites)
En 193, Septime Sévère
dissout les Prétoriens à qui il reproche
leur rôle ambigu dans la succession de Pertinax (assassiné,
tout comme Commode) et l'avènement de Didius Julianus.
En fait il conserve l'institution mais en limoge le personnel
qu'il remplace par des hommes choisis parmi ses légionnaires
pannoniens.
Pour les mêmes raisons, Dioclétien, qui est
Illyrien, donc se méfiant des Pannoniens, se crée
une garde personnelle à partir de deux auxiliats
illyriens qui s'étaient illustrés par leur
talent à utiliser les plumbatæ
(dards lestés, qui se lançaient à la
main, au nombre de cinq, rangés dans la face interne
du bouclier), qui d'ailleurs leur avaient valu le surnom
de «Tireurs de Mars» (Martiobarbuli)
(VÉG., Mil., I, 17).
L'Auguste Jupiter-Dioclétien en fit sa garde impériale,
à lui et à son collègue l'Auguste d'Occident
Hercule-Maximien. Passant du statut d'auxiliats palatins
à celui de légions palatines, ces deux régiments
reçoivent un numéro de matricule : ce seront
les V Iovia et VI Herculia (on lit aussi :
I Iovia et II Herculia), qui deviennent le
fer de lance des comitatenses, les troupes qui accompagnent
l'empereur.
Délogés de leur Castra Prætoria
à Rome, les Prétoriens n'ont d'autre
choix que de soutenir l'usurpateur Maxence, fils de Maximien-Hercule,
contre le putchiste Constantin Ier. Vaincus au Pont Milvius,
le Prétoriens sont définitivement dissous
par Constantin qui les remplace par des soldats à
sa dévotion, les Protectores Domestici (appellation
qui précédemment avait été un
titre honorifique porté par les officiers de confiance).
Ceux-ci sont en fait des cavaliers qui reprennent, semble-t-il,
les fonctions des anciens trois cents Equites Singularis
Augusti de la Garde Prétorienne.
Ces Protectores forment la garde rapprochée
de l'empereur et ne combattent pas sur les champs de bataille
(à la différence des Scholæ Palatinæ).
En 346, les Protectores Domestici (les «Protecteurs
Domestiques», id. est «de la Maison»)
forment deux Scholes de 500 hommes chacune - une d'infanterie,
une de cavalerie - aux ordres du comte des domestiques.
Les Scholæ Palatinæ - elles aussi créées
par Constantin Ier - sont, du IVe au VIIe s., la garde impériale
(mais non «rapprochée») qui, sur le champ
de bataille, remplacent les Prétoriens. Ensuite,
les empereurs ayant généralement renoncé
à personnellement paraître sur les champs de
bataille, leur fonction devient essentiellement protocolaire
(sous Zénon, emp. 474-481).
Comme les Scholaires étaient quasi exclusivement
d'origine germanique, l'empereur Léon Ier «l'Isaurien»
(emp. 457-474) les remplaça par une nouvelle formation
de 300 hommes de sa propre fratrie isaurienne : les Excubites
(littéralement «Ceux qui sortent du lit»,
c'est-à-dire «Ceux qui montent la garde devant
les portes du palais» ou, pour faire court, «les
Sentinelles»). |
|
| |
3.
L'auteur (1928-1990)
«Wallace Breem, écrit
Steven Pressfield (Les Murailles de Feu), fait partie de
cette très courte liste d'auteurs qui élèvent
la fiction historique au niveau du meilleur de la littérature,
tous genres confondus.» À 18 ans, W. Breem
intègre l'école d'officiers de la British Indian
Army avant de rejoindre en 1945 le Corps of Guides avec le
grade de lieutenant. Après la partition des Indes,
il rentre en Angleterre où il devient successivement
ouvrier dans une tannerie, assistant vétérinaire
et collecteur de loyers dans l'East End de Londres. En 1950,
il intègre l'Inner Temple, l'une des quatre prestigieuses
écoles de droit londoniennes où il devient successivement
bibliothécaire puis conservateur des manuscrits. En
1970, il publie L'Aigle de Rome (Eagle in the Snow),
bientôt suivi par deux autres romans (The Legate's
Daughter, 1975 & The Leopard and the Cliff,
1978). Dès sa sortie, le roman connaît un succès
considérable avec plus de dix éditions en anglais
et des traductions en cinq langues. L'Aigle de Rome
est à ce jour considéré comme un classique
du genre «historique militariste».
En 1990, l'Association britannique et irlandaise des bibliothèques
de droit (BIALL) institue en sa mémoire le «Wallace
Breem Award».«Wallace Breem, écrit
Steven Pressfield (Les Murailles de Feu), fait partie de
cette très courte liste d'auteurs qui élèvent
la fiction historique au niveau du meilleur de la littérature,
tous genres confondus.» À 18 ans, W. Breem
intègre l'école d'officiers de la British Indian
Army avant de rejoindre en 1945 le Corps of Guides avec le
grade de lieutenant. Après la partition des Indes,
il rentre en Angleterre où il devient successivement
ouvrier dans une tannerie, assistant vétérinaire
et collecteur de loyers dans l'East End de Londres. En 1950,
il intègre l'Inner Temple, l'une des quatre prestigieuses
écoles de droit londoniennes où il devient successivement
bibliothécaire puis conservateur des manuscrits. En
1970, il publie L'Aigle de Rome (Eagle in the Snow),
bientôt suivi par deux autres romans (The Legate's
Daughter, 1975 & The Leopard and the Cliff,
1978). Dès sa sortie, le roman connaît un succès
considérable avec plus de dix éditions en anglais
et des traductions en cinq langues. L'Aigle de Rome
est à ce jour considéré comme un classique
du genre «historique militariste».
En 1990, l'Association britannique et irlandaise des bibliothèques
de droit (BIALL) institue en sa mémoire le «Wallace
Breem Award». |
4. La collection «Invicta» (Panini
Books)
Avec sa nouvelle collection
«Invicta», initiée par L'Aigle de
Rome de Wallace Breem, les éditions Panini mettent
à la portée du public francophone de passionnants
romans historiques sur l'Antiquité (entre autres).
Nous avons déjà eu l'occasion, sur ce site
d'évoquer cette galaxie d'auteurs anglo-saxons (click).
Outre un «Napoléon & Wellington»
de Simon Scarrow voici, dans le sillage de la Ruée
Barbare de 406, les reconstitution romancées de la
retraite des 10.000 de Xénophon; la rude campagne
d'Alexandre le Grand en Bactriane (Afghanistan); et la chute
en Constantinople qui, en 1453, mit fin à l'Empire
romain d'Orient.
15 octobre 2014
La marche des Dix-Mille (The Ten Thousand
: A Novel of Ancient Greece, 2001)
Michael Curtis FORD, Panini Books éd., coll.
«Invicta»
ISBN : 2809439613 / EAN : 978-2809439618
Résumé
L'histoire authentique d'une odyssée magnifique,
de dix mille guerriers grecs voulant retrouver leur terre,
d'hommes devenus des dieux. En 401 av. n.È., Cyrus
le Jeune, second fils de Darius II, roi des Perses, se soulève
contre son frère aîné afin de lui ravir
le trône. C'est avec cent mille Perses et dix mille
Grecs — qu'il se met en route pour affronter Artaxerxès
II «Longues Mains» à Cunaxa, en Mésopotamie.
Cyrus et son armée y trouvent la mort mais les mercenaires
hellènes, endurcis par trente années de guerre
en Grèce, sortent vainqueurs du combat. Après
avoir engagé de féroces batailles et assisté
à d'indicibles horreurs, ils sont désormais
seuls et sans provisions en pays hostile. Les Dix-Mille
ne désirent rien d'autre que retrouver leur pays.
Menés par Xénophon, jeune soldat inexpérimenté
qui rêve de gloire, ils entament alors une marche
désespérée à travers le désert,
les flots tumultueux et les froides montagnes arméniennes.
Forces hostiles, famine, maladies. Ils traversent l'enfer
avant de rejoindre la Mer Noire.
La Guerre du Péloponnèse vient de s'achever.
Xénophon, jeune aristocrate athénien qui a
jugé bon de s'éloigner de sa patrie après
la restauration de la démocratie (Thrasybulle, –403),
accompagne en dilettante son ami le général
spartiate Chirisophe commandant des mercenaires grecs (dont
800 Lacédémoniens). Après l'exécution
de son mentor par les Perses vainqueurs, il lui faudra le
remplacer au pied levé...
|
| |
11 février
2015
Alexandre le Grand. La campagne afghane
(Alexander : The Afghan Campaign, 2006)
Steven PRESSFIELD, Panini Books éd., coll «Invicta»,
PRIX EDITEUR : EUR 25.00
ISBN : 9782809444452
Résumé
Il y a 2.300 ans, l'armée d'Alexandre le Grand,
invaincue, progressait en Asie et envahissait les terres
d'une tribu de redoutables guerriers orientaux : les Afghans.
Voici l'histoire d'un des soldats du plus grand conquérant
de l'Antiquité... À travers les yeux de Matthias,
un jeune fantassin de l'armée d'Alexandre le Grand,
La Campagne Afghane explore les défis, à
la fois militaires et psychologiques, auxquels Alexandre
et ses soldats doivent faire face lorsqu'ils entreprennent
une guerre d'un nouveau genre.
Ils sont contraints de s'adapter aux méthodes d'un
ennemi impitoyable qui n'hésite pas à employer
la terreur, à se cacher parmi les civils et recruter
des femmes et des enfants pour en faire des combattants.
Matthias rejoint l'armée d'Alexandre après
la conquête de l'Empire perse, alors qu'elle progresse
à travers l'Afghanistan, vers les richesses de l'Inde.
Appartenant à une unité où se côtoient
des recrues de son âge et des vétérans,
le récit de Matthias raconte comment il devient soldat
en suivant les stratégies de terre brûlée
d'Alexandre, en expérimentant les joies et les tristesses
d'une romance avec une jeune Afghane, et en affrontant la
barbarie des Afghans, celle de ses compagnons d'armes comme
la sienne.
Au XIXe s., l'Empire britannique s'y cassa le nez (1839-1919).
L'Armée soviétique y fut éreintée
(1979-1989), et de nos jours encore les Américains
et leurs alliés s'y trouvent enlisés. C'est
dans ces mêmes régions que se déroulèrent
les opérations — moins connues du public —
de la conquête macédonienne : les campagnes
de Bactriane et de Sogdiane, toujours d'actualité.
La Campagne Afghane prouve encore une fois la profonde
compréhension de Steven Pressfield des espoirs et
des souffrances des hommes au combat et des réalités
historiques qui continuent à influencer notre monde.
Du même auteur américain, on se souviendra
de ses flamboyantes Portes de Feu (Gates of Fire,
1998) retraçant la bataille des Thermopyles. |
| |
4 mars
2015
Constantinople : Le siège (Siege,
2010)
Jack HIGHT, Panini Books éd., coll. «Invicta»
ISBN : 2809444250 / EAN : 978-2809444254
Résumé
An 1453. Depuis plus de mille
ans, les imposantes murailles de Constantinople ont protégé
la capitale de l'Empire romain d'Orient, le plus éloigné
avant-poste du christianisme. Mais désormais, des
colonnes interminables de soldats turcs recouvrent la plaine
devant elles, leurs imposants canons braqués vers
les remparts. C'est la force la plus redoutable que le monde
a jamais vue. Aucune armée européenne ne viendra
: les derniers croisés ont été mis
en pièces par les Turcs sur les plaines du Kosovo.
Constantinople ne peut compter que sur elle. Et la trahison
est dans l'air. Trois personnes vont se battre pour le destin
d'un empire : le jeune sultan turc, Mehmed, rentré
d'exil et prêt à tout pour prouver sa grandeur,
une princesse byzantine obstinée, qui a juré
de protéger sa ville, et un mercenaire endurci, Giovanni
Longo, qui a des comptes à régler. Mais c'est
le soldat qui va faire face au plus difficile des choix
: alors qu'il se prépare à ce qu'il pense
être sa dernière bataille, il fait une découverte
qui va lui donner une raison de vivre. |
|
|
NOTES :
(1) Selon saint Jérôme,
les Vandales ariens ne s'interdirent point en cet hiver 406-407
d'allègrement massacrer et «par milliers»
les paroissiens de Mogontiacum en leur église (nous y
reviendrons). Selon Grégoire de Tours (Hist. Francs,
II), le Goth arien Évarix en Gaule et, en Espagne, le
Vandale arien Thrasamund (ca 460-523), arrière-petit-fils
de ce Godégisel tué lors de la traversée
du Rhin, firent périr en grand nombre les catholiques
qui refusaient de se convertir, notamment telle pieuse jeune
fille - dont bizarrement il n'a pas conservé le nom -
qui, ayant refusé le baptême arien, fut soumise
au chevalet, au feu et aux crocs de fer... - Retour
texte
(2) À Rome, le «parti
anti-barbares» en tirera argument pour justifier la disgrâce
et l'exécution de Stilicon. - Retour
texte
(3) PROSPER D'AQUITAINE [PROSPER TIRO,
né en 390], Epitomia Chronicon, col. 590, mentionne
le consulat d'Arcadius [Augustus VI] et Probus [Sextus
Anitius (Petronius) Probus, en Occident] (click).
- Retour texte
(4) Cf. Iaroslav LEBEDYNSKY,
La Grande Invasion des Gaules (407-409), Lemme éd.,
coll. «Illustoria», 2012, pp. 49-52. Un ouvrage
concis, qui fait le tour de la question. - Retour
texte
(5) Sauf semble-t-il les fédérés
Francs. - Retour texte
(6) Telles la I Flavia Gallicana
(pseudocomitatenses) et I Flavia Metis (pseudocomitatenses)
en Gaule [RICHARDOT, p. 92] ou les II Italiciani, I Flavia
Pacis (comitatenses), II Flavia Virtutis (comitatenses)
et III Flavia Virtutis (comitatenses). Cf. Philippe RICHARDOT,
La fin de l'armée romaine (284-476), 3e édition
revue et augmentée avec une traduction de la Notitia
Dignitatum, Economica éd., coll. «Bibliothèque
Stratégique», 2005, p. 94.
Si l'on examine la liste des troupes à la disposition
du duc des Bretagnes, on trouve une assez longue énumération
de cohortes ou d'ailes de cavalerie distinctes, sous le commandement
de tribuns ou de préfets. Ce sont du reste également
des préfets qui commandent les «VIe légion»
(stationnée à York, semble-t-il) et «IIe
légion» (stationnée à Richborough),
qui plusieurs siècles auparavant, sous Claude, avaient
toutes deux, avec les IX et XX, participé
à la conquête de l'île [Notitia dignitatum
- Occidentalis, in RICHARDOT, op. cit., pp. 110-112
et 100]. - Retour texte
(7) Ayant combattu pour l'usurpateur
Magnence, ils avaient depuis - en punition - été
transférés en Orient. À propos des Herculiani,
on se reportera à l'Appendice 2. -
Retour texte
(8) Notons que dans l'ordre de bataille
augustéen, il y avait déjà plusieurs légions
I, II, III etc. du fait de la refonte des légions de
Pompée, César, Antoine, Octave etc. - Retour
texte
(9) In DAREMBERG & SAGLIO, s.v.
«Legio», pp. 1091-1093. - Retour
texte
(10) Notitia dignitatum - Occidentalis,
XL - RICHARDOT, op. cit., pp. 110-112. - Retour
texte
(11) Not. Occ., XII - RICHARDOT,
p. 95. Les Victores iuniores sont classées parmi
les auxiliats palatins (RICHARDOT, p. 85), mais dans l'autre
sens, à l'origine, les Joviens et les Herculiens l'étaient
aussi avant de devenir des légions palatines. - Retour
texte
(12) Not. Occ., VII - RICHARDOT,
p. 97. - Retour texte
(13) Not. Occ., XXVIII - RICHARDOT,
p. 100. - Retour texte
(14) DAREMBERG etc., op. cit.,
p. 1088. - Retour texte
(15) Page 78 de L'Aigle...
les Legio XXX Ulpia et Legio I Minerva sont correctement
situées en Germanie Supérieure, et la Legio
VIII Augusta en Germanie Inférieure, à ce
détail près qu'il convient - question de point
de vue - d'inverser les Germanies Supérieure (qui est
méridionale) et Inférieure (qui est septentrionale).
Du nord au sud, donc, la XXX est à Xanten, la
I à Bonn et la VIII à Strasbourg.
Plus loin, l'auteur énumère différentes
légions qui autrefois furent stationnées à
Mogontiacum : la IV Macedonica sous Auguste, la XIV
Gemina après le désastre de Varus, la XXII
Primigenia à la mort de Néron (anéantie
par les Alamans ainsi que la IV, un siècle auparavant)
et, enfin, la XXX, qui demeura dans la capitale de la
Rhénanie-Palatinat jusque sous Hadrien (L'Aigle...,
p. 200).
En fait, sous Trajan, seule la XXII Primigenia est à
Mogontiacum. La IV Macedonica est alors à Troesmis,
dans le delta du Danube; est également sur le Danube
la XIV Gemina, à Carnuntum (Altenburg, à
l'ouest de Vienne); enfin la XXX «créée
par Domitien» - mort en 96 -, plus probablement créée
en 105 par Trajan comme le suggère son surnom de XXX
Ulpia, est stationnée à Vetera (Birtem, près
de Xanten). - Retour texte
(16) Entendez les cuirasses.
- Retour texte
(17) VÉGÈCE, Traité
de l'art militaire [Epitoma rei militaris], trad. Victor
Develay (1859). - Retour texte
(18) Honorius épousera successivement
deux filles de son protecteur Stilicon : Marie (398) et Thermantie
(408). La première, Marie, mourra vierge après
dix ans de mariage ! Il répudiera la seconde l'année
même de ses épousailles. - Retour
texte
(19) Orose (Contre païens,
VII, 41.8 - cité par LEBEDYNSKY, op. cit., p.
62) semble se réjouir de la future conversion des Huns,
Suèves, Vandales et Burgondes. - Retour
texte
(20) Ce Constantin III est le Custennin
ap Selyf des chroniques galloises, que dans son Histoire
des Rois de Bretagne, GEOFFREY DE MONMOUTH présente
comme un parent d'Uther Pendragon. Cf. la compilation
de Jacques BOULENGER, Les Romans de la Table Ronde (Plon,
1941), U.G.E éd., coll. «10/18», n°s 498-500-502,
1971, 3 vols - vol. 1, p. 95. - Retour
texte
(21) Varus disposait de cinq ou six
légions : outre les trois disparues : la V Alaudae
à Castra Vetera (Xanten - plus tard anéantie par
Civilis, mais ensuite reformée) (?) et, à Mogontiacum
(Mayence), sous le commandement de son neveu L. Nonius Asprenas,
les XIII Gemina et XVI Gallica. - Retour
texte
(22) Soit 16 années de service
au lieu de 20, et doublement de la solde (un denier par jour,
au lieu de dix as). - Retour texte
(23) Les lecteurs de Quo vadis
? se souviendront d'Aulus Plautius, dans le roman converti
au christianisme et père adoptif de l'héroïne,
l'otage Lygia. - Retour texte
(24) Ph. RICHARDOT, op. cit.,
p. 63. - Retour texte
(25) Ph. RICHARDOT, La
fin de l'armée romaine (284-476), op. cit., 2005;
Alain ALEXANDRA & François GILBERT, Légionnaires,
auxiliaires et fédérés sous le Bas-Empire
romain, Errance éd., coll. «Histoire vivante»,
2009. - Retour texte
|
| |
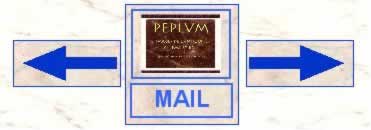 |
|